27/10/2019
La saga de Gérard et Béatrice
Connaissez-vous la saga de Béatrice et Gérard Barras ? Le dernier opus vient justement de paraître.
Chantier ouvert au public
Aujourd’hui la soixantaine, Gérard et Béatrice ont été des précoces. Leur saga commence alors qu’ils ont à peine vingt ans. Le récit de leur première aventure, intitulé "Chantier ouvert au public" - on notera le clin d'oeil libertaire - contait la restauration année après année d'un village qui domine superbement l’Ardèche, le Viel Odon, dont le mélange de beauté et de décrépitude a ému nos héros. La renaissance du Viel Odon se fera à travers une succession de chantiers de jeunesse où les participants apprendront à manier les outils - pelle, truelle, scie, seaux, marteau, brouette et bien sûr j'en passe -, découvriront les richesses du travail d’équipe et de l'intelligence pratique, qu’elle soit individuelle ou collective. Cela sous la houlette d'un Socrate exceptionnel, aussi bienveillant qu'exigeant: Gérard Barras, qui pourrait avoir pour devise: « L’intelligence, ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas » (1). A lire leurs témoignages, on voit que, pour ceux qui ont vécu cette expérience, au delà d’un chantier de restauration, la magie du Viel Odon fut d'être pour eux un chantier de vie, un chantier pour mieux vivre sa vie.
Moutons rebelles
La deuxième aventure, dont le titre enfonce le clou de la résistance aux idées dominantes - "Moutons rebelles » - nous fait entrer dans le mystère d'une renaissance. Au fin fond d'une vallée perdue, à une heure de virages de Valence, nos deux héros découvrent un jour un bâtiment qui attire leur curiosité. Il menace ruine mais contient des machines à filer la laine encore en bon état de marche. Devant ce gâchis, ils ont un sursaut de révolte. Mais, loin s’en faut, il ne suffirait pas d'étayer la toiture et de remettre le matériel en route. C'est toute la filière qui est dans le même état que la fabrique. Et d’abord en amont: n'ayant plus preneurs pour leur laine, les bergers ne peuvent que la jeter et, de ce fait, n'en assurent pas la qualité comme jadis. C’est une chaîne de gâchis qui s’engendrent les uns les autres et c’est tout un système qu'il faudrait reconstruire dont l'usine n'est qu'un élément. Qu'il faudrait ? Qu'il faut ! Et la concurrence internationale ? Toute la rationalité économique dit qu’il ne faut surtout pas se lancer dans cette billevesée ! Mais ils n’y connaissent rien: Gérard est architecte-urbaniste, Béatrice orthophoniste. Alors ? Le succès économique, social, technique, humain d’Ardelaine fera la nique aux théories. Bien sûr, la réussite irrévérencieuse des moutons rebelles - qui iront jusqu’à refuser de dépasser un certain stade de croissance - attirera l’attention et c’est grâce à une conférence de Béatrice, invitée par l’Ecole de Paris du Management, que je ferai leur connaissance.
Une cité aux mains fertiles
Le troisième opus qui est paru il y a quelques jours s’intitule « Une cité aux mains fertiles ». La cité en question est un de ces quartiers où vous n’aimeriez pas vivre. Ou plutôt: où vous n’auriez pas aimé vivre, car les choses ont bien changé. A l’origine un habitat HLM qui, de crise de l’emploi en crise de l’emploi, de migrations en migrations, est devenu un échouage où une soixantaine de nationalités différentes essayent de vivre, chacun se confinant dans la case de son trois ou quatre pièces en observant les autres en chiens de faïence. Les espaces verts sont battus par les courses sauvages de cyclomoteurs. Les parties communes, bien mal dénommées, ne sont revendiquées par personne, à part les bandes de jeunes qui y exercent des activités délictueuses, et les déchets s’accumulent en contre-bas des fenêtres. Là, ce ne sont pas des murs et des toitures qu’il s’agit de redresser, une filière industrielle ou un territoire qu’il s’agit de remembrer. Il s’agit d’ingénierie sociale. Ce sont des êtres humains qui doivent sortir de leurs niches, se parler, s’approprier un bien commun à travers lequel retrouver une vie collective et un cadre de vie digne. La suite de l’histoire, je vous la laisserai découvrir dans le troisième livre de Béatrice !
(1) Jean Piaget.
Béatrice Barras, Une cité aux mains fertiles, Editions REPAS: http://editionsrepas.free.fr/index.html
Les Editions REPAS publient des livres, témoignages d'expériences alternatives et solidaires qui montrent qu'il y a toujours place ici et maintenant, comme hier et ailleurs, pour des réalisations qui inscrivent leur sens dans le concret de pratiques libres et solidaires. Elles souhaitent encourager ainsi ceux qui sont insatisfaits du monde dans lequel ils vivent à faire le pas vers d'autres possibles.
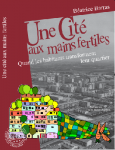
10:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : territoire, société, insertion, alternative, ingénierie sociale, contre-modèle, béatrice barras, gérard barras, ardelaine, valence, viel odon, saint-pierrevile
26/10/2019
Entre l’autruche et l’apocalypse: choisir le bon récit
Les histoires qu’ils se racontent sont les logiciels d’exploitation des êtres humains. On parle souvent de «représentation du monde», mais l’expression évoque une image, comme un tableau, quelque chose de fixe, alors que la vie s’inscrit dans un mouvement du passé vers l’avenir et ne peut donc être représentée que par le mouvement, en conséquence par des récits. Ces récits, nous ne pouvons pas nous en passer. Sans eux, nous serions englués dans l’immédiateté et nous serions réduits à quelques réflexes instinctifs, du genre fuir, se battre ou se figer. Les histoires que nous nous racontons nous permettent de nous projeter au loin, dans le temps et dans l’espace, et de nouer, avec notre environnement et avec nous-même, des relations plus subtiles. Par dessus tout, elles proposent un sens - une signification et une direction - au mystère qu’est l’existence. Mais, en fonction de leur nature, elles nous propulsent ou nous enferment, elles nous conditionnent ou nous libèrent. Si l’on prend à la lettre le terme de logiciel « d’exploitation », une histoire peut être un outil d’asservissement. Le passé comme le présent regorgent d’exemples dans ce sens. Le plus redoutable de nos jours est que, dans notre monde occidental, la science a remplacé la religion comme référence transcendantale et que nous en sommes à produire des histoires qui se refusent à toute mise en question, comme celles que véhicule la doxa économique.
Changer de logiciel
Le 31 janvier dernier, à l’initiative de la Fabrique Narrative, s'est tenue à Paris une journée remarquable intitulée « Le 7e récit » (1). L’idée de ses promoteurs, au premier rang desquels mon ami Pierre Blanc-Sahnoun, était que, victimes de six récits qui ont produit le monde dont nous sommes aujourd’hui prisonniers et qui, au surplus, est en train de s’autodétruire (2), nous ne survivrons qu’à la condition d’en inventer un 7e qui emporte les esprits et les coeurs. Cette démarche, qui relève typiquement du courant des Approches narratives, rejoignait la conviction exprimée quelques mois plus tôt par Rob Hopkins (3), l’initiateur des Villes en Transition, lors des Assises de Sol & Civilisation (4): « Pour nous mettre en marche, il nous faut nous raconter, avait-il dit, des histoires délicieuses sur l’avenir ». Hélas! ce que je vois proliférer en progression géométrique depuis le début de l’année relève surtout de la grande famille des récits d’effondrement ou, pour utiliser le terme devenu commun, de la collapsologie (5).
De l’autruche à l’éco-anxiété
Avant d’aller plus loin, il me faut dire où j’en suis rendu de mes réflexions dans ce domaine. Depuis 1962 et «Printemps silencieux» (6), 1970 et le premier Rapport au Club de Rome, et malgré les nombreuses Cassandre qui se sont succédées depuis lors pour nous alerter, je n’ai pas perçu de progrès vraiment décisifs dans notre rapport au vivant et à la planète. Les six récits énoncés et dénoncés par Pierre Blanc-Sahnoun sont toujours à l’oeuvre avec un acharnement suicidaire. Peut-être ceux à qui ils profitent pensent-ils que la fortune qu’ils leur permettent d’accumuler leur donnera de jouir, le jour de la débâcle, d’une base de repli aussi douillette qu’inexpugnable. Les choses étant ce qu’elles sont et les humains ce qu’ils sont, j’ai tendance à partager le point de vue de l’historien et chercheur Jean-Baptiste Fressoz (7). Selon lui, nous sommes déjà rendus trop loin pour conjurer les périls qui se profilent. Croire que, maintenant, on peut s’en sortir en se mettant debout sur la pédale de frein est une illusion, une perte de temps et une erreur stratégique. L’espoir et la vie sont du côté de l’acceptation de ce qui viendra et de notre préparation. C’est un choix entre l’adaptation en survie et l’adaptation en évolution. C’est aussi le choix de l’histoire que nous allons nous raconter à partir de ce qui nous arrive.
Que l’on partage ce point de vue collapsologiste ou que l’on accepte seulement de considérer que notre situation est tout de même quelque peu préoccupante, reste que, ce dont nous avons besoin, ce n’est évidemment pas de récits qui évacuent la lucidité et nous aveuglent, comme ceux que la publicité nous dispense par tous les canaux imaginables. Mais pas davantage n’avons-nous besoin de récits qui nous brisent le coeur, qui sapent notre énergie et stérilisent notre imagination. « Je ne sais même pas si mes enfants verront leur majorité » déclarait il y a peu une jeune vedette du petit écran (8). Certes, cette déclaration pathétique est émouvante et il convient de ne pas s’en moquer. Elle témoigne d’un phénomène qui serait en train de se développer et que résume un néologisme réducteur: « l’éco-anxiété ». Mais cultiver l’éco-anxiété n’est pas ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, ce sont de récits qui, en respectant la lucidité indispensable, stimulent nos capacités de résilience. Des récits qui nous rendent en même temps joyeux et efficaces, créatifs avec enthousiasme, aventureux (9). Parce que, en réalité, ce que nous avons à démarrer est rien de moins que le chantier d’une nouvelle civilisation, d’une nouvelle alliance avec le Vivant, et si une telle perspective n’est pas jubilatoire, alors, que nous faudra-t-il ?
Effondrement ?
Le mot « effondrement » provoque instinctivement l’image d’un phénomène soudain et écrasant. Sur la côte vendéenne, pas très loin de la baie de Cayola, j’ai assisté à l’effondrement d’une maison. La première fois que je l’ai vue, je n’étais encore qu’un enfant, elle était déjà en ruine, ouverte aux quatre vents, envahie d’herbes et de sable. D’année en année, chaque été, je la retrouvais et elle me semblait à jamais figée dans cet état. J’ai vécu plus de la moitié de ma vie avant de constater sa disparition finale. Aujourd’hui, je ne saurais même plus dire où elle se trouvait. C’est avec cette notion du temps long qu’à l’invitation d’un très cher ami (10) j’ai donné il y a quelques années une conférence dont le titre dit tout du récit que j’ai commencé à me conter : « Crise ou métamorphose ? » J’y citais notamment le concept de Françoise Dolto: le «complexe du homard». Alors qu’il grossit, vient pour cet animal le moment de se dépouiller d’une carapace devenue trop petite. De ce fait, pendant un certain temps, il est en quelque sorte nu et vulnérable. Dolto utilisait cette image pour évoquer les inconforts de l’adolescence, entre l’enfant que l’on n’est plus et l’adulte que l’on n’est pas encore. On pourrait aussi prendre pour image l’effondrement de l’empire romain, qui s’est étalé sur plusieurs siècles, jusqu’à l’apparition d’une civilisation de nouveau stable. Je pense que, pour la construction d’un septième récit, il y a là un élément à prendre en compte - que l’on pourrait appeler « l’entre-temps ». Cet entre-temps inconfortable, éventuellement angoissant ou déprimant, est d’abord celui que nous vivons lorsque nous sommes entre deux Weltanshauungen, entre des représentations de la vie - de la réussite, de l’avenir, de ce qui est bon ou mauvais - qui relèvent de registres différents.
Le sol et l'âme (11)
Autour du concept de 7e récit, il m’est venu une autre réflexion. Comme un arbre pousse ses racines dans le sol et traverse des strates de plus en plus anciennes pour y puiser l’énergie de sa croissance, un nouveau récit peut avoir avantage à plonger ses racines dans des récits pré-existants, là du moins où ils sont encore vivaces. Ce n’est pas d’aujourd’hui que certains d’entre nous ont ressenti les carences narratives de notre société et sont partis à la recherche d’autres choses à se raconter sur la condition humaine que le « toujours plus » de la civilisation occidentale. Par exemple, au cours de ces dernières années, nous avons vu à plusieurs reprises des représentants des nations amérindiennes attirer dans nos salles de conférence un public non négligeable. Nous avons vu, entre autres, des indiens de Colombie, les Kogis, traverser divers cénacles et même faire la une d’un journal d’entreprise. Andreu Sole dans Créateurs de mondes nous conte la rencontre saisissante qu’a été pour lui la confrontation avec l’univers radicalement différent d’où ces visiteurs nous parlent. Cet intérêt pour des cultures lointaines n’est pas propre à la France : face à la menace de la gigantesque carrière projetée par Redland-Lafarge sur l’île de Harris (12), c’est un chef Mi’Kmaq que requerra Alastair McIntosh, l’enfant du pays, pour stimuler la prise de conscience des insulaires.
A la recherche d’âmes-soeurs
Sur un tel sujet, il vaudrait la peine de faire une incursion dans le domaine de la fiction, car celle-ci révèle souvent les aspirations qui nous hantent. Mais la matière est trop riche et, dans le cadre de cet article, il ne peut qu’être esquissé. Il me revient en particulier le souvenir de deux romans et d’un film qui me paraissent significatifs: Chaman de Jean Bertolino (13), L’Evangile du Serpent de Pierre Bordage (14) et Blueberry, de Jan Kounen. Inspiré d’une histoire vraie – celle de l’ethnologue suisse Bruno Manser - Chaman campe un missionnaire catholique qui, de la prédication de l’Evangile, passe à l’animisme et à la révolte. Il conduit la lutte contre les destructeurs de la forêt primaire indonésienne et crée rien de moins qu’un mouvement « éco-mystique » mondial. Dans L’Evangile du serpent, autour de celui qu’on surnomme le « Christ de l’Aubrac » - un jeune amazonien adopté par une famille auvergnate - toute une population découvre qu’elle est malade de son rapport au monde. Enfin, Blueberry met en scène un marshal alcoolique, torturé par son passé. Le casting comprend un véritable chaman, Kestenbetsa, de la tribu des Shipibos. Blueberry se conclut sur l’initiation chamanique du héros et sa vision du serpent cosmique qui relie l’ensemble des êtres. Judik, le personnage de Jean Bertolino, a appris quant à lui à percevoir l’esprit des arbres et à converser avec eux. L’invité Mi’Kmaq d’Alastair McIntosh fera, sur l’île écossaise, cette déclaration qui montre la convergence entre les exemples tirés de la fiction et des aspirations qui émergent au sein de notre société : « Grâce à nos aînés, cette génération-ci […] s’est éveillée de nouveau à la relation spirituelle avec la Terre Mère».
Il me semble cependant que, quelqu’enrichissantes ou réconfortantes que soient ces rencontres exotiques, elles témoignent surtout de notre sentiment de solitude et de l’effort que nous faisons pour trouver les âmes soeurs que notre nouvelle sensibilité ne décèle pas dans notre propre environnement culturel. Cependant, pour la vigueur des nouveaux récits dont nous avons besoin, je pense que l’enracinement, afin qu’il puisse « prendre » comme disent les horticulteurs, doit être plus proche de nous. Pour donner un exemple, dans le récit chrétien, la notion de transformation est fondamentale. L’amour de la Création et des êtres vivants est illustré par l’histoire et les poèmes de saint François d’Assise, le sens d’une humanité en évolution dans les écrits de Pierre Teilhard de Chardin. Indépendamment du lien que l’on peut faire entre les péchés capitaux et l’état actuel de l’humanité et de la planète (15), dans ce terreau de deux mille ans un « septième récit » n’aurait aucun mal à prendre. Il donnerait même un nouveau registre d’expression à un christianisme qui n’a plus à résister aux persécutions des Romains mais aux sirènes des « Big six ».
Mille et un septièmes récits
On peut rêver qu’un génie tel qu’Homère nous chante un jour la nouvelle Odyssée de l’humanité et que nous nous trouvions tous, où que nous soyons à la surface de la Terre, à la reprendre en choeur. Pour le moment, nous n’en sommes pas là et il faut nourrir notre imaginaire pour qu'il surmonte les conditionnements des "Big six" et nous anime face aux changements à venir ou à décider. Alors, ce que nous pouvons faire de plus pertinent, selon moi, est de stimuler la production de milliers de "septièmes récits" qui s'adaptent aux différents médias qui, jour après jour, déversent dans nos yeux et nos oreilles les mèmes des "Big six": les romans, les chansons, les films, les poèmes, les jeux vidéos, les feuilletons, etc.
Faute d’un Homère qui nous emporterait tous dans son lyrisme, je ne crois pas qu’il nous faille un septième récit unique. Ce serait démotivant, dangereux et contre-productif. L’humanité est diverse et il est souhaitable qu’elle le reste. Si l’on peut promouvoir quelques constantes transversales, nécessaires à tous les septièmes récits qui pourraient se développer en subversion des « Big six », il convient, selon moi, d’aiguillonner sans la monopoliser l’activité créatrice. Campbell, dans Le héros aux mille visages, nous a montré que la diversité des mythes n’empêchait pas une sorte de résonance par delà les époques et les lieux. Ne faisons pas avec nos septièmes récits l’erreur que nous avons faite avec le vivant. Si les graines que nous sèmerons veulent bien germer et porter fruit, gardons-nous d’en réduire les variétés comme nous l’avons fait des espèces animales et végétales.
(1)
https://www.lafabriquenarrative.org/blog/communautes-narr...
(2) Les « Big six »: la croissance infinie comme perspective unique, la rentabilité maximale pour l’actionnaire, la performance et la compétition incessantes, la dictature de la conformité et du changement permanent.
(3) https://fr.wikipedia.org/wiki/Rob_Hopkins
(4) https://www.soletcivilisation.fr
(5) Encore qu’il y a de multiples courants y compris celui de l’Apocalypse joyeuse.
(6) Rachel Carson.
(7) https://www.youtube.com/watch?v=lO0r5O4-2wU
(8) Lucie Lucas, actrice principal de la série Clem: https://www.telestar.fr/people/video-lucie-lucas-et-la-fin-du-monde-peut-etre-que-mes-enfants-n-atteindront-pas-437696
(9) C’est le cas des trois récits vécus que conte Béatrice Barras dans Chantier ouvert au public, Moutons rebelles et, le tout dernier, Une cité aux mains fertiles.
(10) Jean-Marie Balout, hélas! prématurément décédé.
(11) Emprunté au titre du livre d'Alastair MacIntosh, cf. infra.
(12) Une des Hébrides.
(13) Jean Bertolino, Chaman, Presses de la Cité, 2002.
(14) Pierre Bordage, L’Evangile du serpent, Le Diable Vauvert, 2001.
(15) Cf. Ma série d’articles sur ce blog.
23/10/2019
Méditation à Colombey

J’aime, de temps en temps, faire pélerinage à Colombey-les-deux-Eglises. La modestie de ce village et le souvenir de grandeur qui l'habite s’y allient à la perfection, tout à l’opposé de la médiatisation permanente de nos politiciens, d’autant plus logorrhéiques et agités qu’ils ont le coeur vide, l’âme inconsistante et la parole torve.
Mon dernier séjour dans le village du Général avait eu pour occasion un séminaire que j’y avais organisé autour d’un thème auquel le lieu me semblait bien se prêter: la prise de décision. Le 17 juin 1940, en effet, deux hommes à la formation identique, militaires jusqu’au bout du képi, deux hommes qui ont vécu la Grande Guerre, ont assisté aux mêmes développement de l’Histoire et ont sous les yeux les mêmes événements, prennent des décisions diamétralement opposées. L’un, à qui est échu le pouvoir, choisit de pactiser avec l’envahisseur; l’autre, qui ne représente que lui-même, s’en va - au nom de la France - poursuivre le combat. On sait quelle cause l’a emporté, mais on ignore souvent ce qu’elle a exigé de stratégie, de foi et de détermination de la part de celui qui l’a embrassée. L’âme, a dit le philosophe Alain, est ce qui résiste. Beau sujet de réflexion qui, pour moi, met en lumière la dialectique de l’âme et de l’intelligence, la fécondation de l’une par l’autre. Si de Gaulle voit les ressources immenses dont dispose encore la France - son empire et ses alliés - c’est qu’il a d’abord dit «non». Si, à la Libération, la France n’a pas vu sa souveraineté passer des mains des Allemands à celles des Américains - le plan AMGOT - c’est qu’il y avait pour lui une réalité au delà des choses matérielles. Ce que de Gaulle a sauvé, c’est la souveraineté de la France non pas seulement face à ses ennemis mais aussi aux appétits de ses alliés.
Sur le chemin du retour, une question a priori étrange m’est venue à l’esprit: la France existe-t-elle encore ? Une nation n’est pas quelque chose de donné. C’est un être virtuel qui prend vie et chair par l’histoire que se racontent ceux qui s’en disent les membres, histoire au sein de laquelle ils puisent une part de leur identité. C’est un creuset où verser nos ambitions personnelles et qui nous ouvre à quelque chose de plus grand que nous, un rêve qui procure un horizon aux décisions que l’on doit prendre, une destination qui permet de distinguer les vents favorables et d’ajuster sa navigation. C’est une manière de se vouloir ensemble au monde. Le résultat de cette nation de l’âme, c’est un peuple en relation singulière avec un territoire dans lequel peut s’enraciner, se cultiver et se nourrir, de générations en générations, une identité toujours menacée, et s’organiser un univers concret. C’est un peuple en relation avec un espace dont il entend garder la maîtrise afin d’y vivre à sa manière et de s’y projeter dans le très long terme sans devoir rendre de comptes à qui que ce soit. C’est le lieu d’où l’on pourra dialoguer avec le reste du monde, sur un pied d’égalité. Existe-t-il encore aujourd’hui quelque chose de tel, que l’on pourrait appeler «la France» ?
Certes, les menaces qui pèsent sur nous ne s’annoncent plus par le martèlement de nos pavés. Les envahisseurs - dans notre région du monde tout au moins - n’ont pas enfilé de bottes et ils se sont revêtus d’une rassurante peau d’agneau. A l’abri de ce simulacre, ils nous ont susurré - et nous sommes nombreux à les avoir crus - que la question du pouvoir et des frontières est une fausse question, que le jeu de l’économie, vraie source de richesse pour tous, dispense de l’intervention de l’Etat et même se passe avantageusement de ce dernier, et qu’il n’y a de problèmes et de solutions que techniques. A moins de vivre au royaume des Bisounours - autre forme de nation virtuelle il est vrai - on ne peut que constater les mensonges de cette chanson-là. Des milliers de suicides de petits paysans ont été la conséquence de l’introduction au Kérala du business model des industries agro-chimiques multinationales. La biodiversité, facteur de résilience de l’écosystème dont notre survie dépend, est partout menacée par les monocultures intensives et la dispersion des OGM. Nos systèmes sociaux, fruits d’un idéal entêté et de siècles de luttes, sont mis à mal par la concurrence de pays qui n’ont d’autre avantage sur le nôtre que les formes modernes d’esclavage qu’on y pratique. La destruction de nos emplois s’accélère, ainsi que la dépendance de nos pays à l’égard de puissances financières dont la force de frappe ne doit rien à l’économie réelle et n’est que le produit d’un enrichissement purement spéculatif. Ces puissances, ici et là, ont même commencé à s’emparer de millions d’hectares sans égard pour les populations qui vivent dessus ou dont l’alimentation en dépend. En même temps, inspirées et parfois financées par les envahisseurs, les législations liberticides se multiplient qui nous empêchent d’expérimenter les moyens de notre propre résilience. Quant à la dette souveraine, elle n’est rien d’autre que la botte de l’envahisseur dans la porte de la maison enfin entrouverte. Demandez à nos amis grecs ce qu’ils en pensent. Demandez aussi aux Islandais. Face aux envahissements de toute sorte - produits, règlementations, prédateurs de tout poil - cette question prétendument ringarde de la souveraineté nationale, parce qu’elle concerne rien de moins que le choix de notre société et de notre avenir, est plus actuelle que jamais.
Pour la première fois dans l’histoire des peuples, ceux-ci ne sont pas principalement ou immédiatement menacés par un belligérant qui déferlerait sur leur sol les armes à la main «pour égorger leurs fils et leurs compagnes». La puissance dont l’ombre s’étend sur le monde n’est pas une horde de barbares hirsutes et braillards ou une armée en ordre de marche avançant au pas de charge. C’est une petite caste apatride qui dirige les oscillations d’une formidable marée monétaire où se mêlent les eaux les plus douteuses. Utilisant des conventions internationales signées par des naïfs ou des corrompus, agitant des colonnes de chiffres prises pour parole d’évangile, plaçant ses agents ici et là au vu et au su de tout le monde, elle opère en toute impunité. Dans un tel monde, seule la nation - si elle veut bien s’assumer - a l’échelle, les moyens et la légitimité qui lui permettent de contenir cette subversion. Au nom de quelle prétendue légitimité supérieure, traité de ceci, directive ou constitution de cela, un peuple, aujourd’hui, n’aurait-il plus le droit et les moyens de refuser ce qu’il considèrerait comme un danger pour son territoire, pour la société qu’il a bâtie, pour l’avenir de ses enfants ? Le 18 juin 1940, en lançant son Appel, le Général de Gaulle a fait apparaître que légalité et légitimité ne coïncident pas nécessairement. Dans la suite des évènements, il a aussi démontré qu’on ne représente pas les destinées d’un peuple en débitant son héritage pour se faire apprécier des autres joueurs.
Charles de Gaulle nous a laissé une histoire, celle d’une nation qui a eu le respect d’elle-même et de ses enfants: si nous acceptons de regarder plus loin que nos peurs et nos soucis égoïstes, c’est la preuve d’amour que ceux qui vivent aujourd’hui peuvent encore donner aux générations qui leur succéderont.
16:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de gaulle, souverainisme, capitalisme, néolibéralisme, france


