17/04/2023
De la dépossession
Je suis un lecteur éclectique et cela me permet de faire parfois des rapprochements inattendus. Récemment, j’ai constaté qu’entre les propos du docteur Louis Fouché et ceux du philosophe américain, Matthew B. Crawford - l’auteur de « L’éloge du carburateur » - les résonances ne manquent pas, singulièrement autour du concept de dépossession. Les points de départ sont différents, les références et le vocabulaire aussi, mais très nettement voilà deux hommes qui, chacun de son côté de l’Atlantique, dénoncent la même dérive de nos sociétés. Nous nous engluons dans un système tentaculaire de sollicitations et d’injonctions qui, les unes et les autres, tendent à nous désapproprier de notre contact personnel au monde et à asphyxier notre liberté créatrice. Ce système est hétérogène, composite, il est à la fois politique, réglementaire, économique, technologique, financier, social. Il conjugue les appétits et les ambitions d'acteurs dont la complicité est peut-être plus souvent d’opportunité que subjective, mais où certains personnages - comme Klaus Schwab, le fondateur et animateur du World Economic Forum - parviennent à insuffler une orientation minimale. L’ensemble constitue une machine à produire à grande échelle un consentement biaisé des masses humaines - c’est-à-dire une soumission - qui n’a jamais été aussi performante. Cette machine utilise une double force: celle de la contrainte et celle de la suggestion. La contrainte s’exprime dans la règlementation, les interdits, les menaces, la surveillance, les sanctions. La suggestion relève de la manipulation mentale utilisée à des fins commerciales ou idéologiques, ou pour produire des réflexes conditionnés au moindre coût.
Le totalitarisme en mode lousdé
Je gage que peu de mes lecteurs sont prêts à accepter l’idée que nous sommes entrés dans une ère de totalitarisme. Le mot rappelle en effet les souvenirs du pire de l’URSS, l’époque des goulags où l’on envoyait les gens dénoncés pour une correspondance privée critiquant le « petit père des peuples » (1). Or, ne voit-on pas tous les jours, dans notre pays, des spectacles qui démontrent à quel point notre liberté s’étend jusqu’à la licence ? Mais monter régulièrement en épingle l’obscénité - les provocations de l’Art contemporain, les excentricités des genristes ou de certaines ultra-minorités sexuelles - n’est qu’un tour de prestidigitation pour retenir notre attention d’aller voir ailleurs. Il y a des libertés spectaculaires sans importance à qui est donné le devant de la scène afin, en coulisse, de mieux étrangler des libertés essentielles. Quand on accepte certaines filouteries dangereuses pour garder le droit de prendre un café, d’aller au cinéma ou de voyager, c’est déjà que l’on n’a pas trouvé le recul nécessaire pour distinguer l’essentiel de l’accessoire. Là est le danger de se perdre. Globalement, qu’il s’agisse des grandes lignes de nos vies ou de notre quotidien, de l’éducation de nos enfants ou de la disposition de nos corps, tout se décide toujours davantage sans nous et nous revient sous une forme comminatoire. En outre, gage d’efficacité, la mise en oeuvre peut désormais s’appuyer sur une technologie aussi banalisée qu’invasive. Le totalitarisme d’aujourd’hui est une pratique en lousdé. C’est une société où certaines formes d’indépendance se réduisent inexorablement et où, petite touche par petite touche, une volonté opiniâtre de contrôle recouvre le paysage de nos vies d’un voile grisâtre. En s’additionnant, des dispositifs liberticides en apparence subsidiaires finissent par tisser un filet aux mailles de plus en plus serrées. C’est, pour la consommation d’énergie, le compteur électrique dit « intelligent ». C’est l’interdiction de détenir chez soi en liquide plus qu’une certaine somme. C’est bientôt, pour voyager, le carnet de vaccination en forme de puce insérée sous la peau. C’est l’allègement de l’étiquetage de certains produits qui réduit la possibilité de faire des choix éclairés ou en tout cas en cohérence avec nos valeurs (2). C’est la propagande genriste à l’école: comme nous l’avait déclaré il y a quelques années une femme politique française: « Vos enfants ne vous appartiennent pas ».
Réalité augmentée ou diminuée ?
On a beaucoup vanté la « réalité augmentée », mais que dire de la réalité diminuée ? Le totalitarisme en lousdé, c’est aussi la censure des opinions divergentes par les mass médias où, si elles sont citées, c’est pour être incendiées. C’est, sur les réseaux sociaux, les documents supprimés - y compris des études officielles - « au nom des standards de la communauté », ou les opinions hypocritement dissimulées par les algorithmes: le shadow banning. Ce sont les centaines de milliers de petits comptes qui disent n’importe quoi sans être inquiétés, parce qu’ils n’ont aucune influence mais servent à démontrer la liberté d’expression tandis que l’on clôture autoritairement ceux qui commençaient à acquérir une véritable audience. Ce sont les trolls diligentés par des officines subventionnées afin de pourrir les fils de discussion. Dans une société où le monde perçu par beaucoup se limite à l’écran de la télévision, ce que l’on n’y voit pas n’est pas perçu comme caché: n’existe pas l’idée même que cela puisse exister. Alors, pour celui qui n’a pas l’intuition ou envie de se poser des questions, de faire ses propres recherches, il n’y a pas d’opinions divergentes, il n’y a que des consensus auxquels on ne peut que se soumettre. On en a fait l’expérience avec l'invisibilisation de scientifiques qui avaient une pensée différente sur le coronavirus, tandis que des experts à conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique hantaient chaque jour les plateaux. On peut aussi évoquer, alors que les politiques les moins représentatifs ou qu’accompagnent un impressionnant lot de casseroles sont invités chaque jour, le bannissement médiatique total de François Asselineau dont la moindre vidéo fait cinq cents fois plus de public que le dernier film, pourtant généreusement subventionné, de Bernard-Henri Lévy.
Les dénonciateurs du « complotisme » oublient de dire que les Etats-unis ont depuis longtemps utilisé Hollywood pour faire passer les narratifs qui les arrangent (3). D’ailleurs les forces spéciales américaines viennent officiellement de déclarer qu’en cas de besoin elles utiliseraient des « deep fakes » au titre de leurs stratégies (4). Distinguer le vrai du faux est déjà de plus en plus difficile: avec le recours à l’intelligence artificielle, cela deviendra une gageure. Cette dernière en effet donne à n’importe quel quidam le pouvoir de créer des images et des articles de presse qui ont toute l’apparence de la vérité tout en n’étant que des inventions. Elle apporte ainsi une puissance inimaginable aux ombres de la caverne dont Platon voulait nous détourner. Or, comme l’a écrit Hannah Arendt: « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez ». Aux forces que ce système déploie s’ajoutent des phénomènes tels que le wokisme qui tend à nous priver de nos repères, ainsi que les différents mouvements de repentance qui veulent nous enfermer dans une passion triste qui nous vide de notre énergie.
La flamme de l’attention
Mais la dépossession majeure que l’on nous inflige, sans laquelle rien de ce qui précède ne serait facile à imposer, est celle de notre attention. Krishnamurti faisait de l’attention la porte d’entrée de notre esprit, la clé de notre vie: sur quoi la focalisons-nous, de quoi la nourrissons-nous ? Or, la capter est devenu un enjeu pour tous ceux qui attendent quelque chose de nous et, entre les marchands, les gouvernements et les colporteurs d’idéologies diverses, les prédateurs de notre attention sont devenus innombrables. Il y a quelques décennies, il fallait ouvrir un journal, allumer le poste de radio ou de télévision, ou choisir d’assister à un meeting, pour être exposé à ce battage. Maintenant, nous le sommes en permanence. C’est une omniprésence de messages ou plutôt d’interpellations et de leurs vecteurs - essentiellement tout ce qui est doté d’un écran. Combien de temps passons-nous chaque jour à lire des informations que nous n’avons pas sollicitées ? Combien à nous laisser embobiner par le jeu des commentaires sur les réseaux sociaux ? Combien de fois, tentés de ne pas ouvrir cette boîte de Pandore, avons-nous hésité en nous disant: « Il y a peut-être quelque chose à apprendre ou à partager ? »
Au surplus, des images savamment calculées passent la barrière de notre filtre conscient pour influencer notre inconscient. Derrière tout cela il y a un autre projet: celui de nous éduquer, c’est-à-dire de nous faire adopter des mœurs, des croyances et des comportements décidés par des élites autoproclamées. Comme l’a montré Virginie Martin (5), les séries télévisées contribuent largement, au delà des histoires dont elles prétendent nous distraire, à faire évoluer la culturendes peuples. Ce que nous pouvons voir et devons penser, ce qu’est le bonheur, ce que c’est qu’être un humain, le bien, le mal, le gentil, le méchant, où doit aller notre société, tout cela nous est administré en perfusions indolores. En sommes-nous seulement conscients ?
Nous sommes les auteurs de ce monde
Ce monde ne sort pas d’un chapeau. Il n’est pas l’oeuvre d’un démiurge diabolique. Toutes les civilisations résultent des choix que, dans un environnement donné, une population a faits afin de satisfaire ses besoins. D’une part, chacun de ces choix crée un afflux d’énergie vers certains secteurs qui s’enrichiront et auront ainsi tendance à s’autonomiser et, de réponse à un besoin, à devenir des lieux de pouvoir surplombant la société (6). D’autre part, dans ces choix faits au fil du temps et parfois des siècles, quelques motivations spontanées et répétées ont joué un rôle déterminant: a été plébiscité ce qui « facilite la vie », ce qui donne le sentiment d’être davantage protégé, ce qui valorise les premiers expérimentateurs aux yeux des autres et ce qui enrichit matériellement. Chacune de ces motivations débouche sur une pente douce au début mais qui ne manque jamais de s’accélérer, cela d’autant que le marketing de ceux qui y ont intérêt y encouragera. Si la motorisation de certaines tâches constitue un véritable soulagement pour les ouvriers et les paysans, que dire par exemple de la télécommande de nos téléviseurs ? A combien de mètres regarde-t-on l’écran ? Se lever pour changer de chaîne représente-t-il une fatigue singulière ? A lui seul, cependant, combien de matière et d’énergie cet objet fabriqué par milliards d’unités consomme-t-il ? Combien de déchets représente-t-il ? Et, parmi cent autres objets de notre quotidien qui nous poussent sur la même pente, quel effet a-t-il sur l’évolution de nos comportements ? A sa modeste place, la télécommande est symbolique de la manière dont nos choix, innocemment, engendrent un monde et nous façonnent en retour.
L’organisation de la résignation
Le pouvoir se concentre à mesure de la richesse. Avec la mondialisation, cette concentration est à l’échelle de la planète. Elle a engendré des monstres de puissance économique et financière qui interfèrent dans tous les secteurs de nos vies. Leur collusion avec un pouvoir politique qu’elles ont de plus en plus souvent contribué à mettre en place nous prive des plus élémentaires garde-fou. De ce point de vue, nous devons remercier la prétendue « crise sanitaire »: elle a rendu visible une réalité qui relevait jusque là d’un roman dystopique. Elle nous permet de comprendre par exemple que si, un jour proche, l’OMS décide, pour notre bien et celui de la planète, de contrôler notre alimentation, il lui suffira de passer des accords avec ceux qui lui auront d’ailleurs susurré cette idée à l’oreille: les industriels de l’alimentaire, les chaînes internationales de restauration, etc. Que les législateurs nationaux rajoutent à cela quelques normes ou obligations pesantes, qu’une crise énergétique opportune survienne, et les petits commerces indépendants finiront par mettre les uns après les autres la clé sous la porte. C’est la logique du totalitarisme: le nombre, l’hétérogénéité et l’indépendance des acteurs sont un obstacle au projet qu’il s’agit de mettre en place. Sous les prétextes d’économies et d’efficacité, il est indispensable donc de simplifier la réalité, de ne voir qu’une seule tête et de n’avoir que des interlocuteurs de niveau planétaire. Une fois encore, la gestion de la crise du covid est riche d’enseignements: on a neutralisé des centaines de milliers de médecins libéraux qui avaient les compétences de soigner et guérir, parce qu’il fallait réserver le terrain à une politique planétaire unique et aux productions de la grande industrie pharmaceutique. Mis entre parenthèses et l’ayant accepté sans résistance, ces professionnels n’ont pas vu que c’était le début de la pente qui les conduirait à être évincés au profit des plateformes de consultations à distance assistées de la nouvelle baguette magique: l’intelligence artificielle. Et voilà qu’émerge un système de santé dont nous - les citoyens - nous satisferons par défaut !
Tout s’organise pour que nous soyons convaincus qu’il n’y a devant nous qu’une seule route, qu’il serait vain de vouloir en trouver une autre et que, de toute façon, nous sommes désormais impuissants. Cela aussi est une marque de l’esprit totalitariste. « There is no alternative! » comme le scandait Margaret Thatcher et comme le reprennent en coeur tous ses épigones. Si, à l’intérieur de leur système, il n’y a pas d’alternative, il y en a en revanche en dehors. La nouvelle route n’est pas à trouver: elle est à créer. Le nouveau film n’est pas à choisir dans le catalogue: il est à imaginer. Nous ne sommes jamais prisonniers que des réponses que nous avons choisi de donner et continuons à donner à nos besoins. En cela il n’y a pas de faute et il ne doit pas y avoir de culpabilité: l’humanité apprend en marchant. La seule faute serait, aujourd’hui, de ne pas prendre en compte ce que nous voyons et ce que nous avons la capacité de comprendre. Si, aujourd’hui, nous nous sentons à l’étroit dans notre société de 2023, l’histoire des besoins dont nous avons privilégié la satisfaction et les réponses additionnées que nous leur avons données nous permettrait de comprendre comment nous en sommes rendus là. Mais, quelque intéressant qu’il serait, ce n’est pas un travail historique que je veux vous proposer au terme de ce constat. Il s’agit d’avenir, il s’agit d’innovation et d’invention et c’est ce dont il sera question dans ma prochaine chronique.
(1) C’est ce qui est arrivé à Soljenitsyne.
(2) La Commission européenne envisage de supprimer les mentions caractérisant le mode d’élevage des volailles pour simplifier les normes de commercialisation: https://www.tf1info.fr/conso/video-etiquetage-des-volaill...
(3) Erwan Benezet, Barthélemy Courmont, Hollywood-Washington, Comment l’Amérique fait son cinéma, Armand Colin, 2007.
(4) https://www.les-crises.fr/psyops-les-forces-speciales-us-...
(5) Virginie Martin, Le charme discret des séries, humenSciences, 2021.
(6) J’ai évoqué ce phénomène ici: http://indisciplineintellectuelle.blogspirit.com/archive/...
08:59 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : louis fouché, matthew b. crawford, covid, wef, réglementation, schwab, big pharma, société
20/09/2020
La liberté et le sentiment de liberté
Jusqu’à l’arrivée du covid, les espaces publics au grand air - les rues, les places, les quais, les rivages, les marchés de plein vent - étaient des lieux où l’on se sentait libre. Certes, il y avait des règles formelles ou informelles à respecter: la courtoisie, le code de la route avec ses feux de circulation et ses passages pour piétons, les conventions vestimentaires. Mais, à part pour certains d’entre nous à qui un panneau limitant la vitesse à 80 km / heure fait les mêmes effets qu’un chiffon rouge, la frustration était nulle. Dans le monde d’avant, on respirait donc librement. La seule autorité que l’on ressentait était notre autorité intérieure, autrement dit notre liberté au sein d’un monde organisé. Peut-être étions-nous simplement bien adaptés.
Depuis le confinement et même avec le déconfinement, la sensation qui prédomine est celle de l’omniprésence d’une autorité extérieure. « Big brother is watching you. » Ce gente de situation est d’autant plus pesant que l’autorité en question ne nous semble pas mériter notre confiance, voire même que nous avons des doutes quant à sa légitimité. Ce point est à souligner, car il peut y avoir là une zone de fracture potentielle. En attendant, avec ou sans masque, l’air que nous respirons dans la rue en est comme appauvri de son oxygène. Peut-être cela passera-t-il et avons-nous seulement besoin d’un temps d’adaptation à ces règles plus restrictives, après lequel nous retrouverons notre ponctuellement souffreteux sentiment de liberté. Peut-être la fin de l’avant-dernier film de Clint Eastwood, La Mule, est-t-elle une métaphore du bonheur que nous pouvons attendre de l’avenir.
Dans l’espace privé, bien qu’évidemment plus étroit, on respire un peu mieux. Mais seulement parce que le contrôle ne s’y exerce pas directement. Pas encore. Cependant, en attendant que les pandores ou les smartphones viennent s’y assurer de nos comportements, pour la première fois dans l’histoire les injonctions à la distanciation sociale et au port du masque sont répétées ad nauseam par la radio et la télévision. Je dois avouer que je commence à en avoir assez du storytelling de « René qui prépare le barbecue » et de « Selim qui rend visite à sa grand-mère ». Vivement qu’il pleuve sur le barbecue de René et que Selim aille voir sa grand-mère au cimetière !
Le débat sur le masque n’en finit pas. Est-il efficace, ne l’est-il pas ? Que pourrait-il cacher d’autre que notre visage ? On se souviendra que son histoire a commencé avec des déclarations unanimes de nos dirigeants et experts. « Les masques n’ont aucun intérêt pour le grand public » (Jérôme Salomon, médecin infectiologue, directeur général de la Santé, BFMTV, 4 mars). « Le port de masque, en population générale dans la rue, ça ne sert à rien » (Edouard Philippe, Premier ministre, TF1, 13 mars). « Je suis surpris de voir par la fenêtre de mon ministère le nombre de personnes qui sont dans la rue avec des masques (…) alors que cela ne correspond pas à des recommandations » (Olivier Véran, médecin, ministre de la Santé, déclaration à la presse, 16 mars). Les mêmes, sans rougir, sans présenter d’excuses, sans faire amende honorable, ont transformé ce masque qu’ils disaient inutile en impératif catégorique. Il est même devenu une menace de punition pour les dévergondages collectifs que seraient des retrouvailles familiales. Tous ces aspects triviaux ne doivent pas nous faire oublier la dimension symbolique de l’affaire, qui est sans doute première.
Derrière ce débat qui frise parfois l’empoignade, il y a au moins trois logiques d’action: la logique sanitaire, la logique relationnelle et la logique de la liberté. Les mauvais esprits en rajouteront une quatrième: la logique politique. Aujourd’hui, je vous laisserai explorer vous-mêmes ce terrain.
La logique sanitaire est une logique de précaution. A ce titre, on ne saurait trop faire peur aux enfants afin qu’ils ne traversent pas la rue. A partir de là, on peut repérer l’amplification naturelle à cette logique : chacun, par sécurité, rajoute son tour de vis afin de ne pas être plus tard accusé d’une coupable incurie. Avec une telle dérive, on peut en venir à tuer les gens pour leur éviter de tomber malades. Quant à l’efficacité des mesures, à leur opportunité ou à leurs dégâts collatéraux, les opinions même scientifiques sont divisées comme tout ce qui touche depuis le printemps à cette épidémie. Donc, on les adoptera toutes, ensemble ou successivement. Même si l’on ne pourra jamais rien prouver, lorsqu’on sera sorti de l’auberge - à condition d’en sortir - on pourra toujours leur attribuer tout ou partie de notre salut et chacun de leurs promoteurs pourra réclamer sa part de la gratitude populaire.
La logique sanitaire actuelle est en opposition impitoyable avec la logique relationnelle. Celle-ci vient de nos tripes: nous sommes des êtres sociaux, affectifs, dont les sens sont orientés à la communication. Les poignées de main, les bises, les étreintes, quand elles sont interdites, constituent un appauvrissement cruel de notre vie sensorielle. Le visage de l’autre, quand nous pouvons le voir, est en général la première chose que nous regardons de lui, qui nous parle de lui, de ce qu’il vit dans le moment, de ce qu’il peut représenter pour nous. Le philosophe Alain disait que la bouche est plus révélatrice de quelqu’un que ses yeux. Les expressions du visage qui partent des mâchoires précisent nos mots, les teintent d’émotion, de sincérité ou de mensonge, parfois même les remplacent. Sous le masque, nous pouvons sourire, faire la grimace, esquisser un baiser ou tirer la langue, nos yeux en diront si peu et de manière tellement ambiguë que l’incommunicabilité prévaudra. Si l’on devait porter durablement cette muselière, sans doute faudrait-il apprendre une gestuelle compensatrice.
Enfin, il y a la logique de la liberté. Le masque est quelque chose que je n’ai jamais porté de ma vie, qu’à tort ou à raison m’impose une autorité qui à l’origine le déconseillait. Si j’ai un caractère naturellement discipliné, voire soumis, je n’en aurai pas beaucoup d’états d’âme. Il se peut même que la figure du protecteur en filigrane de ces injonctions me rassure. En revanche, si j’ai le rapport à l’autorité sourcilleux, ce n’est pas la même histoire. Pour citer à nouveau Alain: « Si quelqu’un veut empêcher ma liberté, je la lui prouve témérairement ». En tout cas, j’aimerais ici pointer une autre dérive que je trouve dangereuse: chez un certain nombre de personnes, la discipline des gestes entraîne l’abdication de la pensée. Il leur est difficile de porter le masque tout en gardant leur esprit critique. Un pas de plus et, même en étant aussi respectueux des règles qu’elles, si vous vous autorisez à exprimer le moindre doute devant elles, vous serez accusé de délit d’opinion.
Eprouver le sentiment de la liberté est relatif aux situations que nous vivons et à ceux avec qui elles nous confrontent. Ce sentiment est relié à des symboles qui sont différents selon les individus. Pour certains, c’est le choix du vêtement, pour d’autres le rapport au temps, au langage, à l’occupation de l’espace public, etc. Parfois, le sentiment de la liberté a besoin de se vivre plus intensément et c’est alors l’entrée en transgression, en résistance ou en lutte. Il y a deux formes vestimentaires apparemment opposées qui nous invitent à nous écarter d’une opinion binaire : le niqab et le crop top. On peut décider que porter l’un ou l’autre est une forme de soumission: la collégienne qui montre son nombril adhère à une dynamique grégaire promue par les réseaux sociaux, la musulmane qui à l’inverse se voile de la tête aux pieds à une coutume séculaire maintenue par les mâles. Mais on peut aussi imaginer que la collégienne, face aux injonctions puritaines des adultes, affirme sa liberté en adhérant à un mouvement provocant, et que la femme voilée revendique son identité culturelle face à ce que notre société - pour elle étrangère - entend lui imposer. Dans les deux cas, il y a en même temps l’acceptation d’un conformisme et l’exercice d’une résistance.
L’économie du sentiment de liberté résulte donc de la façon dont je réponds à ces deux questions:
- face à qui veux-je en priorité affirmer que je suis libre ?
- entre plusieurs conformismes, lequel sied-il à l’identité que je cultive ou veux afficher ?
Mais, dans la situation où nous nous retrouvons du fait de l’épidémie, la question fondamentale est plutôt celle de la liberté que du sentiment de liberté:
- jusqu’où sommes-nous prêts à échanger des pans de notre liberté contre une sécurité plus ou moins démontrée ?
En poussant le bouchon un peu plus loin:
- Au delà de quel niveau de restriction, le risque est-il préférable à la sécurité ?
16:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : niqab, crop top, liberté, masque, pandémie, gestes barrières, risque, société
27/10/2019
La saga de Gérard et Béatrice
Connaissez-vous la saga de Béatrice et Gérard Barras ? Le dernier opus vient justement de paraître.
Chantier ouvert au public
Aujourd’hui la soixantaine, Gérard et Béatrice ont été des précoces. Leur saga commence alors qu’ils ont à peine vingt ans. Le récit de leur première aventure, intitulé "Chantier ouvert au public" - on notera le clin d'oeil libertaire - contait la restauration année après année d'un village qui domine superbement l’Ardèche, le Viel Odon, dont le mélange de beauté et de décrépitude a ému nos héros. La renaissance du Viel Odon se fera à travers une succession de chantiers de jeunesse où les participants apprendront à manier les outils - pelle, truelle, scie, seaux, marteau, brouette et bien sûr j'en passe -, découvriront les richesses du travail d’équipe et de l'intelligence pratique, qu’elle soit individuelle ou collective. Cela sous la houlette d'un Socrate exceptionnel, aussi bienveillant qu'exigeant: Gérard Barras, qui pourrait avoir pour devise: « L’intelligence, ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas » (1). A lire leurs témoignages, on voit que, pour ceux qui ont vécu cette expérience, au delà d’un chantier de restauration, la magie du Viel Odon fut d'être pour eux un chantier de vie, un chantier pour mieux vivre sa vie.
Moutons rebelles
La deuxième aventure, dont le titre enfonce le clou de la résistance aux idées dominantes - "Moutons rebelles » - nous fait entrer dans le mystère d'une renaissance. Au fin fond d'une vallée perdue, à une heure de virages de Valence, nos deux héros découvrent un jour un bâtiment qui attire leur curiosité. Il menace ruine mais contient des machines à filer la laine encore en bon état de marche. Devant ce gâchis, ils ont un sursaut de révolte. Mais, loin s’en faut, il ne suffirait pas d'étayer la toiture et de remettre le matériel en route. C'est toute la filière qui est dans le même état que la fabrique. Et d’abord en amont: n'ayant plus preneurs pour leur laine, les bergers ne peuvent que la jeter et, de ce fait, n'en assurent pas la qualité comme jadis. C’est une chaîne de gâchis qui s’engendrent les uns les autres et c’est tout un système qu'il faudrait reconstruire dont l'usine n'est qu'un élément. Qu'il faudrait ? Qu'il faut ! Et la concurrence internationale ? Toute la rationalité économique dit qu’il ne faut surtout pas se lancer dans cette billevesée ! Mais ils n’y connaissent rien: Gérard est architecte-urbaniste, Béatrice orthophoniste. Alors ? Le succès économique, social, technique, humain d’Ardelaine fera la nique aux théories. Bien sûr, la réussite irrévérencieuse des moutons rebelles - qui iront jusqu’à refuser de dépasser un certain stade de croissance - attirera l’attention et c’est grâce à une conférence de Béatrice, invitée par l’Ecole de Paris du Management, que je ferai leur connaissance.
Une cité aux mains fertiles
Le troisième opus qui est paru il y a quelques jours s’intitule « Une cité aux mains fertiles ». La cité en question est un de ces quartiers où vous n’aimeriez pas vivre. Ou plutôt: où vous n’auriez pas aimé vivre, car les choses ont bien changé. A l’origine un habitat HLM qui, de crise de l’emploi en crise de l’emploi, de migrations en migrations, est devenu un échouage où une soixantaine de nationalités différentes essayent de vivre, chacun se confinant dans la case de son trois ou quatre pièces en observant les autres en chiens de faïence. Les espaces verts sont battus par les courses sauvages de cyclomoteurs. Les parties communes, bien mal dénommées, ne sont revendiquées par personne, à part les bandes de jeunes qui y exercent des activités délictueuses, et les déchets s’accumulent en contre-bas des fenêtres. Là, ce ne sont pas des murs et des toitures qu’il s’agit de redresser, une filière industrielle ou un territoire qu’il s’agit de remembrer. Il s’agit d’ingénierie sociale. Ce sont des êtres humains qui doivent sortir de leurs niches, se parler, s’approprier un bien commun à travers lequel retrouver une vie collective et un cadre de vie digne. La suite de l’histoire, je vous la laisserai découvrir dans le troisième livre de Béatrice !
(1) Jean Piaget.
Béatrice Barras, Une cité aux mains fertiles, Editions REPAS: http://editionsrepas.free.fr/index.html
Les Editions REPAS publient des livres, témoignages d'expériences alternatives et solidaires qui montrent qu'il y a toujours place ici et maintenant, comme hier et ailleurs, pour des réalisations qui inscrivent leur sens dans le concret de pratiques libres et solidaires. Elles souhaitent encourager ainsi ceux qui sont insatisfaits du monde dans lequel ils vivent à faire le pas vers d'autres possibles.
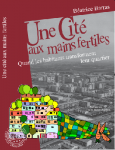
10:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : territoire, société, insertion, alternative, ingénierie sociale, contre-modèle, béatrice barras, gérard barras, ardelaine, valence, viel odon, saint-pierrevile


