11/10/2020
Résister, c’est penser
Certificat d’études en poche à l’âge de douze ans, Lucien, mon futur père, et un de ses cousins s’en allèrent louer leurs jeunes bras dans les fermes alentour. Ma grand-mère, veuve de guerre d’un journalier agricole, n’avait qu’un petit potager; la Vendée d’alors était loin de tout et son économie totalement paysanne. Ils trouvèrent du travail chez un « propriétaire ». Le contrat: logés sous une soupente, nourris à la table du maître et une paye à la mesure de leur âge. Cependant, Lucien se posa très vite des questions sur la pitance qui était servie le soir, bien maigre à vrai dire. Il aurait pu penser qu’en ces années d’après-guerre la vie était dure pour tout le monde et faire confiance à l’ordre des choses. Mais il avait un doute. Aujourd’hui, il serait qualifié de complotiste. Une nuit, il redescendit discrètement l’échelle qui menait à son grenier et lorgna par une fente des volets. Son doute fut levé: une fois les gamins censés dormir, les maîtres se remettaient à table. Son cousin serait peut-être resté, lui s’en alla sur le champ sans tirer sa révérence.
Je suis un peu le reflet, à ma manière, de ce morceau de vie. De par la posture prospective de mon métier mais aussi du fait des expériences que j’ai vécues, je suis habitué à remettre en question les histoires dominantes et à aller voir instinctivement au delà du halo que projète le réverbère. On ne fait pas de prospective en campant sur l’idée qu’à quelques degrés près demain sera comme aujourd’hui. On ne contribue pas au développement de l’humain si l’on se contente du récit qui fige les individus dans un rôle définitif. S'il devait en être ainsi, nos efforts seraient inutiles. Mais l’histoire, les histoires, qu’elles soient collectives ou personnelles, sont pleines de bifurcations que peu de gens ont vu venir. Les « ça c’est toujours passé comme cela » ou « je la connais, elle ne changera pas », ou encore « c’est un expert qui le dit », expressions péremptoires qui invitent certains à dormir, sont pour moi le signal de l’assaut. Les siècles abondent d’experts pontifiants qui se sont trompés, d’erreurs que l’on a mis des décennies et parfois des siècles à débusquer, d’individus qui ont brisé le moule dans lequel on les enfermait. Le mystère du futur est une semence dissimulée dans le présent. Peut-être, même, n’est-elle pas dissimulée et nous crèverait-elle les yeux si nous savions seulement les ouvrir.
Curiosité, audace et imagination
A une telle école, une des conséquences est que, systématiquement, on doute. Mais le doute n’est-il pas le pilier de la philosophie cartésienne ? Doutant, on descend l’échelle et on va regarder par la fente des volets, ou alors on prend sa lampe de poche et on va voir plus loin. « La vérité est ailleurs » proclamait une affiche dans le bureau de 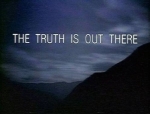 Fox Mulder*. L’invraisemblable n’est jamais qu’un rapport à nos croyances sur les choses ou les êtres. Avant toute véritable avancée, il y a la reconnaissance de notre incommensurable ignorance, qui nous invite à l'école de la curiosité. C’est, dans le monde, la recherche des fameux signaux faibles et, chez l’autre, celle des « fines traces » d'une histoire préférée chères aux Approches narratives. C’est aussi et surtout peut-être une école de l’audace. Puisque j’essaye de percevoir les contours de ce que personne ne décrit, d’une réalité que personne ne garantit et qu’à la limite on nie ou travestit, si je veux avancer en compréhension je suis bien obligé de m’autoriser de moi-même. Enfin, c’est une école de l’imagination. En effet, quand en grande partie le paysage est noyé dans les brumes de l’incertitude, il s’agit de rapprocher des éléments qui émergent, éloignés les uns des autres, en apparence même étrangers entre eux, pour essayer de se le représenter. Toutes les combinaisons de signaux, certes, ne sont pas signifiantes, mais certaines - et pas les moins surprenantes - le sont. Comme le disait Napoléon Ier: « Il n’arrive que l’imprévu ».
Fox Mulder*. L’invraisemblable n’est jamais qu’un rapport à nos croyances sur les choses ou les êtres. Avant toute véritable avancée, il y a la reconnaissance de notre incommensurable ignorance, qui nous invite à l'école de la curiosité. C’est, dans le monde, la recherche des fameux signaux faibles et, chez l’autre, celle des « fines traces » d'une histoire préférée chères aux Approches narratives. C’est aussi et surtout peut-être une école de l’audace. Puisque j’essaye de percevoir les contours de ce que personne ne décrit, d’une réalité que personne ne garantit et qu’à la limite on nie ou travestit, si je veux avancer en compréhension je suis bien obligé de m’autoriser de moi-même. Enfin, c’est une école de l’imagination. En effet, quand en grande partie le paysage est noyé dans les brumes de l’incertitude, il s’agit de rapprocher des éléments qui émergent, éloignés les uns des autres, en apparence même étrangers entre eux, pour essayer de se le représenter. Toutes les combinaisons de signaux, certes, ne sont pas signifiantes, mais certaines - et pas les moins surprenantes - le sont. Comme le disait Napoléon Ier: « Il n’arrive que l’imprévu ».
La crise sanitaire
L’épidémie, sa proclamation, son administration, les effets collatéraux de celle-ci et surtout ses nombreuses zones d’ombre, proposent aux citoyens que nous sommes censés être une singulière matière à penser.
Oui, mais…
Quand nous nous étonnons de certains phénomènes sociaux, comme la crédulité des gens, leur docilité aux mesures les plus abracadabrantes ou la naïveté que traduisent les réponses à certains sondages, nous n’imaginons pas ce que représente pour beaucoup d’entre nous, qui ne sont pas « rodés » à le faire, la conduite d’une investigation au sein d’une société de divertissement surabondant. Concevoir l’idée qu’il peut exister des informations qui, pour n’être pas servies au 20-heures par des notables, méritent cependant au moins autant d’intérêt; les trouver, les comparer, prendre le temps nécessaire, se fier à sa jugeote et s’exposer au jugement d’autrui, tout cela peut paraître rebutant au possible. Pourtant, il ne manque pas de faits qui devraient susciter en nous l’urgence de le faire. Ne trouvez-vous pas extravagante cette opération qui, d’un médicament qui existe depuis soixante-dix ans et qui est administré continûment à des millions de personnes pour les protéger de la malaria, a fait une substance soudainement toxique ? Cela ne vous incite-t-il pas à vous interroger sur la nature cachée du monde dans laquelle nous sommes, du spectacle qu’il prétend nous donner ?
A défaut de conduire une réflexion déterminée, sans peur et sans vergogne, ce sont les réflexes conditionnés, le psittacisme, qui prennent le dessus sur la faculté de penser. Car il n’y a pas que l’estomac des chiens de Pavlov qui réagit au stimulus de la clochette, notre cerveau aussi peut devenir une machine digne des Temps Modernes de Chaplin. Que se passe-t-il quand la pensée démissionne ? Nous pouvons imaginer des « couches de sédimentations culturelles » superposées, comme des « applis » que nous activons paresseusement en fonction des situations à traiter. La plus profonde de ces couches sédimentaires - acquise dès les premiers jours d’école - énonce qu’il existe deux statuts: celui des sachants qui parlent et celui des non-sachants qui doivent, immobiles, muets, les écouter. Le verbe « écouter » en l’occurence est à entendre comme « se taire » et « obéir ». Des années plus tard, cela donne : « Face aux experts des médias et aux ministres de la République, tu fais partie de ceux qui n’ont pas l’intelligence nécessaire pour s’intéresser à la vérité, qui n’ont pas à réfléchir mais seulement à faire ce qu’on leur dit de faire ». Intériorisé, ce discours donnera par exemple: « Moi, je n’ai pas fait d’études de médecine, je n’ai pas fait l’ENA, je fais confiance à ceux qui savent ».
Et si les sachants ne sont pas d’accord entre eux ?
Et si les sachants ne sont pas d’accord entre eux ? Eh! bien, à condition évidemment que nous soyons conscients de leur différend, c’est là que par défaut peuvent s’intercaler des programmes de secours. Le choix de notre opinion dépendra de ceux que nous avons enregistrés au cours de notre vie. Par exemple, pour les uns, le plus grand nombre a forcément tort; pour les autres il a forcément raison. Pour les uns, ceux qui ont l’air marginaux sont forcément du bon côté; au contraire, pour les autres, ils ne peuvent être que du mauvais. Ou encore: quelqu’un qui ressemble au père ou à la mère, pour les uns ne pourra être que spécieux, pour les autres que fiable. Sans que nous nous fatiguions, ces mécanismes décideront ainsi pour nous. Cela rappelle que, pour certains de nos concitoyens, le choix de voter pour Emmanuel Macron se fit sur la rencontre d’une aspiration légitime à « autre chose » avec le style du gendre idéal. Nombre de femmes ont même voté pour lui par sympathie pour le jeune mari d’une épouse de leur âge. Ainsi, en l’absence d’un effort rationnel, l'on accorde ou non sa confiance sur la base de critères sans rapport avec le sujet. Un réchauffiste la donnera plus facilement à quelqu’un qui partage ses convictions climatiques qu’au professionnel plus compétent mais climato-sceptique avéré. Sur un sujet qui n’a pourtant rien de politique, on rejettera les avis scientifiques de celui qui - même s’il n’en fait pas partie - semble attirer les gens dont on honnit les idées. Faire l’impasse de la pensée, c’est exploiter des amalgames dénués de sens.
Malheur à qui sème le doute !
J’évoquais le doute. Le doute est le ferment de l’intelligence. Mais, vous l’aurez vraisemblablement remarqué, malheur à celui qui le sème ! Le doute est l’ennemi, tant pour un troupeau soucieux de préserver sa torpeur intellectuelle que pour ceux qui s’arrogent d’en être les bergers. Entre les deux, il y a malheureusement une forme de connivence.
Une des subtilités de mon métier a été d’offrir à des cadres une sorte d’école buissonnière au sein d’organisations où certains hommes de pouvoir, afin de les mener plus facilement, ne voulaient surtout pas de ce qu’ils brocardaient du terme de « tourisme intellectuel ». Notez bien qu’il ne s’agissait pas de remettre en question le fonctionnement du management. Il ne s’agissait que de prospective et d’explorer, sur le mode de l’intelligence collective, l’évolution des tendances qui, en nous et autour de nous, produisent la matrice de l’avenir. Heureusement, j’ose le dire, l’honnêteté de mon travail me faisait bénéficier de soutiens décisifs, mais j’ai dû jouer parfois très fin et n’ai pas toujours réussi à éviter une certaine forme de censure. C’est pourquoi, aujourd’hui, alors que - nous le ressentons tous, je le crois - les sociétés humaines sont à la croisée des chemins, je suis particulièrement sensible à des faits que l’instrumentalisation de l’épidémie a - dangereusement selon moi - multipliés. Je citerai des vidéos arbitrairement supprimées par les plateformes de réseaux dits sociaux, ou ce manifeste de 200 scientifiques interdit de publication - après avoir été accepté - par rien de moins que le JDD**. Je ne m’imaginais pas que ce genre de chose pût se produire dans mon pays et, pour moi, au delà de l’affront fait au peuple français, c’est un légitime motif d’inquiétude.
Une condition de la démocratie
Si un régime est démocratique, la phrase attribuée à Voltaire n'y souffre pas d’exception : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dîtes, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Venant après les conférences qui furent annulées par peur d’ultra-minorités violentes, la censure des publications dessine dans notre pays l’alliance menaçante de deux phénomènes croissants: la volonté dominatrice des uns, la couardise des autres. Mais, quel que soit le contexte, que la parole y soit libre ou contrôlée, la démocratie n’est viable qu’avec des citoyens qui font l’effort de penser.
* Dans la série « X Files », à côté d’une autre affiche: « Le gouvernement nous ment ».
** https://covidinfos.net/covid19/censure-les-pr-toussaint-t...
16:14 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pandémie, démocratie, prospective, narrative, penser, résister
20/09/2020
La liberté et le sentiment de liberté
Jusqu’à l’arrivée du covid, les espaces publics au grand air - les rues, les places, les quais, les rivages, les marchés de plein vent - étaient des lieux où l’on se sentait libre. Certes, il y avait des règles formelles ou informelles à respecter: la courtoisie, le code de la route avec ses feux de circulation et ses passages pour piétons, les conventions vestimentaires. Mais, à part pour certains d’entre nous à qui un panneau limitant la vitesse à 80 km / heure fait les mêmes effets qu’un chiffon rouge, la frustration était nulle. Dans le monde d’avant, on respirait donc librement. La seule autorité que l’on ressentait était notre autorité intérieure, autrement dit notre liberté au sein d’un monde organisé. Peut-être étions-nous simplement bien adaptés.
Depuis le confinement et même avec le déconfinement, la sensation qui prédomine est celle de l’omniprésence d’une autorité extérieure. « Big brother is watching you. » Ce gente de situation est d’autant plus pesant que l’autorité en question ne nous semble pas mériter notre confiance, voire même que nous avons des doutes quant à sa légitimité. Ce point est à souligner, car il peut y avoir là une zone de fracture potentielle. En attendant, avec ou sans masque, l’air que nous respirons dans la rue en est comme appauvri de son oxygène. Peut-être cela passera-t-il et avons-nous seulement besoin d’un temps d’adaptation à ces règles plus restrictives, après lequel nous retrouverons notre ponctuellement souffreteux sentiment de liberté. Peut-être la fin de l’avant-dernier film de Clint Eastwood, La Mule, est-t-elle une métaphore du bonheur que nous pouvons attendre de l’avenir.
Dans l’espace privé, bien qu’évidemment plus étroit, on respire un peu mieux. Mais seulement parce que le contrôle ne s’y exerce pas directement. Pas encore. Cependant, en attendant que les pandores ou les smartphones viennent s’y assurer de nos comportements, pour la première fois dans l’histoire les injonctions à la distanciation sociale et au port du masque sont répétées ad nauseam par la radio et la télévision. Je dois avouer que je commence à en avoir assez du storytelling de « René qui prépare le barbecue » et de « Selim qui rend visite à sa grand-mère ». Vivement qu’il pleuve sur le barbecue de René et que Selim aille voir sa grand-mère au cimetière !
Le débat sur le masque n’en finit pas. Est-il efficace, ne l’est-il pas ? Que pourrait-il cacher d’autre que notre visage ? On se souviendra que son histoire a commencé avec des déclarations unanimes de nos dirigeants et experts. « Les masques n’ont aucun intérêt pour le grand public » (Jérôme Salomon, médecin infectiologue, directeur général de la Santé, BFMTV, 4 mars). « Le port de masque, en population générale dans la rue, ça ne sert à rien » (Edouard Philippe, Premier ministre, TF1, 13 mars). « Je suis surpris de voir par la fenêtre de mon ministère le nombre de personnes qui sont dans la rue avec des masques (…) alors que cela ne correspond pas à des recommandations » (Olivier Véran, médecin, ministre de la Santé, déclaration à la presse, 16 mars). Les mêmes, sans rougir, sans présenter d’excuses, sans faire amende honorable, ont transformé ce masque qu’ils disaient inutile en impératif catégorique. Il est même devenu une menace de punition pour les dévergondages collectifs que seraient des retrouvailles familiales. Tous ces aspects triviaux ne doivent pas nous faire oublier la dimension symbolique de l’affaire, qui est sans doute première.
Derrière ce débat qui frise parfois l’empoignade, il y a au moins trois logiques d’action: la logique sanitaire, la logique relationnelle et la logique de la liberté. Les mauvais esprits en rajouteront une quatrième: la logique politique. Aujourd’hui, je vous laisserai explorer vous-mêmes ce terrain.
La logique sanitaire est une logique de précaution. A ce titre, on ne saurait trop faire peur aux enfants afin qu’ils ne traversent pas la rue. A partir de là, on peut repérer l’amplification naturelle à cette logique : chacun, par sécurité, rajoute son tour de vis afin de ne pas être plus tard accusé d’une coupable incurie. Avec une telle dérive, on peut en venir à tuer les gens pour leur éviter de tomber malades. Quant à l’efficacité des mesures, à leur opportunité ou à leurs dégâts collatéraux, les opinions même scientifiques sont divisées comme tout ce qui touche depuis le printemps à cette épidémie. Donc, on les adoptera toutes, ensemble ou successivement. Même si l’on ne pourra jamais rien prouver, lorsqu’on sera sorti de l’auberge - à condition d’en sortir - on pourra toujours leur attribuer tout ou partie de notre salut et chacun de leurs promoteurs pourra réclamer sa part de la gratitude populaire.
La logique sanitaire actuelle est en opposition impitoyable avec la logique relationnelle. Celle-ci vient de nos tripes: nous sommes des êtres sociaux, affectifs, dont les sens sont orientés à la communication. Les poignées de main, les bises, les étreintes, quand elles sont interdites, constituent un appauvrissement cruel de notre vie sensorielle. Le visage de l’autre, quand nous pouvons le voir, est en général la première chose que nous regardons de lui, qui nous parle de lui, de ce qu’il vit dans le moment, de ce qu’il peut représenter pour nous. Le philosophe Alain disait que la bouche est plus révélatrice de quelqu’un que ses yeux. Les expressions du visage qui partent des mâchoires précisent nos mots, les teintent d’émotion, de sincérité ou de mensonge, parfois même les remplacent. Sous le masque, nous pouvons sourire, faire la grimace, esquisser un baiser ou tirer la langue, nos yeux en diront si peu et de manière tellement ambiguë que l’incommunicabilité prévaudra. Si l’on devait porter durablement cette muselière, sans doute faudrait-il apprendre une gestuelle compensatrice.
Enfin, il y a la logique de la liberté. Le masque est quelque chose que je n’ai jamais porté de ma vie, qu’à tort ou à raison m’impose une autorité qui à l’origine le déconseillait. Si j’ai un caractère naturellement discipliné, voire soumis, je n’en aurai pas beaucoup d’états d’âme. Il se peut même que la figure du protecteur en filigrane de ces injonctions me rassure. En revanche, si j’ai le rapport à l’autorité sourcilleux, ce n’est pas la même histoire. Pour citer à nouveau Alain: « Si quelqu’un veut empêcher ma liberté, je la lui prouve témérairement ». En tout cas, j’aimerais ici pointer une autre dérive que je trouve dangereuse: chez un certain nombre de personnes, la discipline des gestes entraîne l’abdication de la pensée. Il leur est difficile de porter le masque tout en gardant leur esprit critique. Un pas de plus et, même en étant aussi respectueux des règles qu’elles, si vous vous autorisez à exprimer le moindre doute devant elles, vous serez accusé de délit d’opinion.
Eprouver le sentiment de la liberté est relatif aux situations que nous vivons et à ceux avec qui elles nous confrontent. Ce sentiment est relié à des symboles qui sont différents selon les individus. Pour certains, c’est le choix du vêtement, pour d’autres le rapport au temps, au langage, à l’occupation de l’espace public, etc. Parfois, le sentiment de la liberté a besoin de se vivre plus intensément et c’est alors l’entrée en transgression, en résistance ou en lutte. Il y a deux formes vestimentaires apparemment opposées qui nous invitent à nous écarter d’une opinion binaire : le niqab et le crop top. On peut décider que porter l’un ou l’autre est une forme de soumission: la collégienne qui montre son nombril adhère à une dynamique grégaire promue par les réseaux sociaux, la musulmane qui à l’inverse se voile de la tête aux pieds à une coutume séculaire maintenue par les mâles. Mais on peut aussi imaginer que la collégienne, face aux injonctions puritaines des adultes, affirme sa liberté en adhérant à un mouvement provocant, et que la femme voilée revendique son identité culturelle face à ce que notre société - pour elle étrangère - entend lui imposer. Dans les deux cas, il y a en même temps l’acceptation d’un conformisme et l’exercice d’une résistance.
L’économie du sentiment de liberté résulte donc de la façon dont je réponds à ces deux questions:
- face à qui veux-je en priorité affirmer que je suis libre ?
- entre plusieurs conformismes, lequel sied-il à l’identité que je cultive ou veux afficher ?
Mais, dans la situation où nous nous retrouvons du fait de l’épidémie, la question fondamentale est plutôt celle de la liberté que du sentiment de liberté:
- jusqu’où sommes-nous prêts à échanger des pans de notre liberté contre une sécurité plus ou moins démontrée ?
En poussant le bouchon un peu plus loin:
- Au delà de quel niveau de restriction, le risque est-il préférable à la sécurité ?
16:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : niqab, crop top, liberté, masque, pandémie, gestes barrières, risque, société
29/06/2020
What if* : Une histoire de friches
Au terme d’un itinéraire professionnel qui l’avait déplacé aux quatre coins de la France et quelques années à l’étranger, Serge avait décidé de revenir dans sa bourgade natale. Il y avait retrouvé quelques amis de son enfance. Chacun, visiblement, avait vécu sa vie et vieilli à sa manière. Il avait été invité à rejoindre un club service local et, à son grand soulagement, avait constaté que la moyenne d’âge de ses membres était d'une génération de moins que lui. On y trouvait aussi quelques membres du conseil municipal. Les réunions se tenaient dans le salon privé du café-restaurant La Fraternité. L’atmosphère y était à la fois chaleureuse et épicurienne, les activités utiles - même si, au goût de Serge, il y manquait un peu d’originalité.
- Quoi ? Tu es devenu fou ?
C’était Onésime, surnommé « le Schtroumpf noir », qui, comme cela lui était coutumier, venait d’exploser. Au fur et à mesure que Serge avait développé l’idée qui lui était venue, la petite assistance - moins de dix personnes - l’avait vu virer au cramoisi.
Quand Serge avait retrouvé ses amis ce soir-là, quelques jours après le début du déconfinement, un article de presse découpé par Marc, dit « Le Geek », passait de main en main. Il était illustré d’une photographie où l’on voyait des hommes et des femmes à la peau sombre faire une queue d’une centaine de mètres pour la nourriture que distribuait une association. Regardant, avant de s’asseoir, par dessus l’épaule de Joël qui n’avait pas fini de le lire, Serge avait vu le titre : « Quand la crise sanitaire se mue en crise alimentaire ».
- Où cela se passe-t-il ? » demanda-t-il.
- En France, mon ami ! En région parisienne » lui avait répondu Marc.
Il avait poursuivi:
- J’ai découvert que la ville de Paris n’a que trois jours de stocks alimentaires devant elle. On considère que c’est normal. Mais quand cela coince quelque part, ce sont d’abord les pauvres qui en pâtissent.
- Ce ne doit pas être propre à Paris…" avait commenté Serge, l'air pensif.
- Alors, qu’en penses-tu, toi qui préfères les navets aux pétunias ? » lui avait alors jeté le Schtroumpf noir.
A son retour dans sa ville natale, Serge s’était fait remarquer par une tribune libre dans la feuille de chou locale. Il y présentait le mouvement des Incroyables Comestibles (1) et concluait, pour frapper les esprits, que « des vergers ou des jardins partagés seraient davantage adaptés à l’époque que les pelouses et les pétunias entretenus à grands frais d'eau et de personnel par la mairie».
En réponse à l’interpellation d’Onésime, Serge avait rappelé que leur département, pour rural qu’il parût, ne produisait que 10% de la nourriture qu’on y consommait.
Cela avait commencé à agacer Onésime:
- Où trouves-tu de pareilles énormités ? Mets des lunettes: la campagne nous environne de partout !
- C’est exact. Mais qu’est-ce qu’on y produit dans notre campagne ? Des céréales !
- Et alors, avec quoi travaille ton boulanger ?
Danièle intervint:
- Pendant le confinement, beaucoup de gens se sont mis à faire des gâteaux, certains même leur pain, et devinez ce qui s’est passé ? »
Marc, attrapant la balle au bond:
- Notre minotier n’avait pas assez de blé pour produire la farine qu’on lui demandait.
- En effet", confirma un autre, "pendant quelques jours on a eu du mal à trouver de la farine. Faut dire aussi que certains faisaient des stocks !"
Serge reprit:
- Pas seulement. Nos céréales, dans leur quasi-totalité, quittent le département. Vers d’autres départements mais surtout vers l’étranger et elles prennent ici la place des cultures vivrières qui pourraient être consommées localement.
- Et nos marchés de village, qu’en fais-tu ? Ils regorgent de tout ! » s’était exclamé Onésime.
- Leur apparente abondance est loin de compte avec ce qu’il nous faudrait pour être autonomes.
Onésime maugréa:
- Mais pourquoi faudrait-il être autonome ? Nous vendons, nous achetons, ça roule ! Non ?
Danièle:
- D’après ce que j’ai lu, le confinement a privé l’agriculture de personnel saisonnier. Faute de pouvoir les récolter et les transporter, de grandes quantités de fruits et de légumes ont pourri. Quel gâchis, alors que des gens n’ont pas à manger !
- Tu vois, si on cultivait à proximité des consommateurs, il n’y aurait pas eu ce gâchis qui m’attriste tout autant que toi. On aurait trouvé des solutions pour les récolter.
Onésime, de plus en plus agacé:
- Des solutions ? Quelles solutions ? Dans vos rêves !
Danièle, s’efforçant au calme:
- L’an passé, qui donc avait organisé le ramassage de ses fruits par ses clients? Corinne ? A l’entrée du verger, on te donnait un panier en te disant comment faire, au retour on pesait ce que tu avais pris et tu avais une ristourne pour avoir fait la cueillette toi-même. Les gens avaient beaucoup aimé, ils avaient passé un bon moment tout en faisant des économies.
- Pour autant, je ne les vois pas faire cinquante kilomètres pour aller chercher des framboises ! Sans parler des frais d’essence.
- Justement ! C’est bien ce que dit Serge: il faut produire au plus près !
Onésime, s'entêtant :
- Mais la situation que nous avons vécue était exceptionnelle ! A vous entendre, elle va devenir la règle !
Serge avait repris posément la parole:
- Elle a eu le mérite de nous montrer la fragilité du système. Le nombre de choses « exceptionnelles » qui peuvent provoquer disettes ou famines est en train d’augmenter.
Il craignait toujours un peu de passer pour un « Monsieur-Je-sais-tout », mais il avait cependant évoqué ensuite quelques-uns des « bugs » qui pouvaient affecter la régularité de l’approvisionnement alimentaire.
- Alors, tu es contre la mondialisation ? Pour l’autarcie ?
- Ce qui m’intéresse, c’est que, quoi qu’il arrive, dans un monde fragile, nous ayons tous à manger en tant que de besoin. Comme le disent les Anglais: la preuve du pudding, c’est quand on le mange. Les théories économiques ou politiques, ça ne remplace pas une assiette de soupe.
Marc:
- Churchill disait: « La distance entre la civilisation et la barbarie, c’est cinq repas ». On a vu récemment des échauffourées pour une playstation soldée. Qu’est-ce que ce serait au troisième jour d’une disette ! (2)
Serge :
- Il y a une chose qui me frappe. D’un côté, malgré l’agriculture intensive, l’artificialisation des sols, etc. on voit presque partout des bouts de terre cultivables et non cultivés. De l’autre, on a dans notre pays des gens qui ne mangent pas à leur faim et qui ne peuvent pas s’intégrer, l’économie détruisant plus d’emplois qu’elle n’en crée. On a aussi, dans notre village, de plus en plus de maisons qui ne trouvent personne pour les occuper et qui se délabrent.
- Pour cela, tu as raison ! La petite place Bergougniasse, qui était si agréable, est devenue un village fantôme. De toutes ces maisons fermées, pas une sur dix qui n’ait fait l’objet d’une effraction. Vous devinez ce qu'il s’y passe !
Danièle:
- Je me souviens de ce que me racontait mon père de son enfance: ma grand-mère, veuve de guerre, faisait vivre la famille en cultivant un terrain de quelques ares. Elle avait aussi des poules et des lapins. Le recours au marché était limité à ce qu’elle pouvait acheter en revendant ses oeufs et ses volailles. C’était loin d’être la richesse, c’était une économie de subsistance, mais elle et ses trois enfants n’ont jamais manqué de nourriture malgré les problèmes économiques.
- On a aussi des jardinets devenus impropres au jardinage parce que bétonnés ou asphaltés afin d’en réduire l’entretien!
- Quand les gens sont chez eux, ils font ce qu’ils veulent !
- Bien sûr. Mais le peu de fruits ou de légumes qu’ils pourraient produire allègerait la pression sur le marché en cas de problème. Vous le savez aussi bien que moi, il faut des semaines pour faire pousser un radis et des mois pour un poireau : on ne peut pas improviser au moment où la crise surgit.
- Serge, où veux-tu en venir ?
- L’image que j’ai à l’esprit est celle du Père Ceyrac que nous connaissons tous ici. Missionnaire en Inde, il avait remarqué que, où il était, deux populations étaient traitées comme moins que rien, complètement abandonnées: d’un côté les veuves et de l’autre les orphelins des rues. Il a eu l’idée de créer une organisation qui les rapprochait: les orphelins s’occupaient des veuves et réciproquement.
- Je ne vois pas le rapport…
- En rapprochant deux misères, au lieu de les additionner, il les a considérablement réduites. Voilà où je voulais en venir: pourquoi serait-il idiot de rapprocher des malheureux, nos terres en friche et nos maisons en déshérence ?
C’est à ce moment-là qu’Onésime avait explosé.
- Quoi ? Tu es devenu fou ? Tu veux ramener ici la misère du monde ! On n’a pas assez de problèmes ?
Bien qu’il eût exprimé la vague crainte que plusieurs d’entre eux avaient ressentie aux propos de Serge, tout le monde éclata de rire.
- Le problème qu’on a, Onésime, c’est que nous sommes en train de mourir ! Les gens partent, géographiquement ou au cimetière, les exploitations agricoles ont de plus en plus de mal à trouver des repreneurs, nos commerces survivent de plus en plus difficilement, bientôt on va nous fermer l’école, le bureau de poste… Nous sommes en train de devenir des friches ! Tu veux que je te fasse un dessin ?
- Ton idée est généreuse, c’est vrai… » commença Danièle, pensive.
- Généreuse ? Même pas, pragmatique.
C’est alors que Claudius qui jusque là était resté silencieux intervint:
- Voyez-vous, à la sortie de Grospetit, le bâtiment abandonné que les anciens appelaient « la fabrique » ?
- Tu veux parler de la « maison des rats » ? Pour sûr qu’on la voit ! Qu’est-ce qu’on attend pour la raser ! Malgré les panneaux, il y a des gamins qui vont y jouer, un jour ou l’autre il y aura un accident !
- En fait," reprit Claudius, "à l’origine, ce n’était pas une fabrique au sens où on l’entend aujourd’hui. Au XIXe siècle, la ville de Paris a voulu se débarrasser des mendiants qui encombraient ses rues, chapardaient aux étalages et ennuyaient le bourgeois. Elle a acheté un terrain de plusieurs hectares, a fait construire ce bâtiment aujourd’hui en ruines, et les mendiants furent invités à y aller apprendre à vivre de leur potager.
- L’invitation a dû être musclée !
- Je ne sais pas. J’ai lu l’étude d’un historien, le professeur Roger, qui conclut que, pour la plupart d’entre eux, ce fut positif: non seulement ils en retirèrent une amélioration matérielle mais aussi une réhabilitation sociale.
- Tu voudrais que l’on fasse la même chose ?
- Je ne dis pas forcément cela. Mais, mutatis mutandis, l’exemple peut être inspirant.
- Cela me fait penser à ce gars qui emmène des délinquants mineurs en grande randonnée. Le juge leur donne à choisir entre la prison et un ou deux mois à crapahuter. Il paraît qu'au retour, la grande majorité de ces jeunes rentre dans le rang et ne replonge plus (3). Le jardinage a peut-être les mêmes vertus...
- Eh! bien, avant d’inviter la misère du monde et son cortège de délits et de bagarres, je préfèrerais qu’on attire les Parisiens que le confinement a dégoutés de la capitale. Avec le télétravail, ce ne devrait pas être trop compliqué.
- Si tu fais venir des Parisiens, on n’en pas fini avec tout ce qui les dérange: le chant des coqs, le braiment des ânes, les odeurs d’étable, le son des cloches, l’absence de fibre….
Danièle:
- Serge, qui sont les gens auxquels tu songes ?
Pris de court, Serge décida in petto d’enfoncer le clou:
- Ceux de la photo.
- Misère ! » s’exclama Onésime.
- Onésime, des gens qui seraient prêt à travailler la terre pour vivre mieux et dignement, ce sont a priori des gens honnêtes, non ? » répliqua Danièle un peu vivement.
- Ah! oui ? Et comment tu les trouves ?
- Rien ne prouve d’ailleurs qu’ils savent déjà travailler la terre ?
Claudius précisa alors:
- La commune de Paris avait salarié des jardiniers professionnels pour accompagner ses indigents.
Danièle complète:
- On a ici quelques « néo-paysans » qui aideraient sûrement aussi. C’est dans leurs valeurs. Mais comment entrer en contact avec les gens dont parle Serge et savoir à qui on a affaire ?
Le Schtroumpf noir se leva d’un bond, repoussant brutalement sa chaise qui tomba avec fracas derrière lui.
- J’en ai assez entendu ! Si vous voulez continuer avec vos billevesées, ce sera sans moi! Bonsoir la compagnie !
Il sortit sans même relever son siège et claqua la porte derrière lui. Les amis se regardèrent, mi-gênés mi-amusés.
- C’est dommage qu’il ait des a priori et un aussi un sale caractère, car il a le coeur sur la main." commenta Danièle.
Joel:
- Cela dit, je le comprends un peu… Faire venir des gens comme ceux dont tu parles…
Puis:
- Serge, tu ne m’as pas convaincu, mais j’aimerais quand même que tu développes ton idée.
- A vrai dire, l’idée n’est pas réfléchie. Elle m’est venue en voyant l’article apporté par Marc. Si l’on voulait l’explorer, il nous faudrait prendre contact avec des gens qui fréquentent en direct ces populations afin qu’ils nous disent si, d’après eux, certaines familles seraient capables de jouer le jeu.
Claudius:
- Il faudrait en premier lieu savoir ce que nous pouvons offrir: faire l’inventaire des friches et des maisons abandonnées pour voir dans quelles conditions les mettre à la disposition de ces nouveaux « colons ».
Serge:
- Cela permettrait d’avoir une idée de la faisabilité. Mais il faudra impérativement organiser des échanges avec notre population. Qu’elle s’empare du projet, qu’elle en soit co-auteure: c'est une condition de la réussite.
- Oui, il faut que les gens qui choisiraient de venir vivre ici se sentent les bienvenus...
- Ce n'est pas gagné. Des Onésime, il doit y en avoir d’autres dans le village.
Marc:
- Si l'on trouvait une famille candidate qui vienne se présenter et parler, cela aiderait. Souvent, cela bloque à cause des caricatures que les gens se font les uns des autres quand ils ne se connaissent pas.
Danièle:
- C'est un serpent qui se mord la queue! Par quel bout le prendre ? Les terres ? Les maisons ? L’accompagnement ? Le financement ? Les gens à inviter ? Les gens d’ici ?
- Et à partir de quand laisser filtrer l'idée ?
(La suite de l’histoire est laissée à l’imagination du lecteur)
* What if : référence au dernier ouvrage de Rob Hopkins Et si on libérait notre imagination. Cf. son site: https://www.robhopkins.net/
(1) http://lesincroyablescomestibles.fr/
(2) https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2801659-20200...
(3) En France, sur la même idée Bernard Ollivier a créé Le Seuil: https://assoseuil.org/ .
06:56 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : humanitaire, autonomie alimentaire, famine, pandémie, friches, villes moyennes, migrants, pauvreté


