04/09/2020
La crise du Covid 19: une opportunité ?
On sait que le thème des bifurcations de vie m’est cher. Je lui ai consacré plusieurs conférences. A cela une raison très simple : au cours de mon existence, j’ai fait plusieurs fois l’expérience des bifurcations, que ce fût celles auxquelles j’aspirais et qui ne se produisaient pas, celles qui me tombaient dessus sans que je les eusse souhaitées ou encore celles que j’avais voulues et qui généraient des effets collatéraux inattendus. Comme j’ai toujours eu un ardent désir de comprendre, j’ai scruté les processus à l’œuvre et, plus particulièrement, les mécanismes d’un clinamen qui, à une période particulièrement difficile de ma vie, m’a procuré un nouveau départ salvateur.
Il manquait à mon expérience celle d’un évènement qui implique l’ensemble de la société et vienne interférer avec les trajectoires personnelles. Ainsi furent entre autres pour nos parents et nos grands-parents les deux guerres mondiales. En ce qui me concerne, le deuxième de ces conflits eut pour effet de retarder de cinq ans l’union de mes parents. Ils avaient projeté de se marier en septembre 39: étant militaire de carrière, au lieu de se rendre à l’église mon père s’est retrouvé au front puis, à la suite de la débâcle, prisonnier de guerre jusqu’à la Libération. Sans cela, j’aurais pu naître au début des années 40. Mais aurait-ce été moi ?
Avec l’épidémie de covid et les mesures de sécurité sanitaire prises par nos gouvernements, nous faisons l’expérience d’une telle interférence. Débouchera-t-elle sur une bifurcation collective majeure, cela reste à voir. Les aspirations dans ce sens ne manquent pas, mais les forces de rappel sont puissantes et cette bifurcation-là pourrait ne pas être celle que l’on imagine. Certes, cette interférence n’est pas celle d’une guerre, néanmoins elle est de niveau historique car ce que nous vivons depuis le début de l’année n’avait encore jamais été vécu et nous sommes amenés à nous poser des questions de tous ordres, depuis les puissances véritables qui organisent notre monde jusqu’à la meilleure façon de vivre notre vie. Ce qui paraissait impossible au point de n’avoir même pas été pensé a fait irruption dans le champ des possibles: je veux parler d’une épidémie qui entraîne des mesures de protection liberticides dont on peut craindre qu’elles soient durables et récurrentes. Parallèlement, le dernier rempart de la confiance, l’autorité que l’on accordait jusque là aux scientifiques, a été miné par leurs dissensions parfois hystériques et le dévoilement de mécanismes douteux. Ce sont des piliers de notre représentation du monde qui ont ainsi été ébranlés. Les tempêtes pourront s’apaiser, mais que ce soit dans notre vie matérielle, relationnelle ou intérieure, nous ne retrouverons pas notre monde d’avant: il s’agit donc bien d’une bifurcation.
L’ébranlement de nos habitudes et de nos croyances engendre de nouveaux possibles, sous la forme d’abord de questions que nous nous posons, puis d’aspirations qui apparaissent ou s’affirment, et enfin d’esquisses d’action. J’ai lu par exemple que neuf cadres sur dix envisageraient de s’éloigner de Paris et de le région francilienne, une partie d’entre eux ayant déjà entamé des investigations. Si les aspirations mentionnées n’ont rien de vraiment nouveau - diminuer le stress et le coût du logement, protéger la vie personnelle et familiale - nul doute que l’épidémie de coronavirus et la politique de sécurité sanitaire des pouvoirs publics ont stimulé ce mûrissement. D’une part, alors que les grandes pandémies, comme celle de la grippe espagnole de 1918, semblaient à jamais loin de nous, l’apparition de cet étrange Covid, restée mystérieuse, fait que nous n’avons plus la conviction d’être protégés par le progrès. Pour un peu, ce serait même le progrès qui nous menacerait. D’autre part, nous avons vu la différence entre vivre les contraintes de cette politique à Paris et en Ile de France et les vivre loin des grandes conurbations. Ajoutez à cela le sentiment d’un paysage urbain de plus en plus à la dérive et d’un ensauvagement irrépressible de la société: si une goutte d’eau peut faire déborder le vase, que dire d’une averse ! L’avenir nous dira l’étendue et la profondeur des transformations sociales en germination, mais, vous l’aurez peut-être perçu en me lisant, alors que la course de nos sociétés est de plus en plus malsaine, le choc de la crise sanitaire peut éveiller en nous l’énergie de changer le récit de notre vie personnelle et collective.
Vous connaissez les trois réactions à une menace: le combat, la fuite ou la tétanie. Il peut y avoir du bon dans la fuite. La peur peut donner l’impulsion que ne suscitent pas les ruminations. Tout le monde connaît l’apologue de la grenouille jetée vivante dans une marmite remplie d’eau : dépensant son énergie à s’adapter à l’élévation insensible de la température, elle finit cuite. Ne nous arrive-t-il pas d’être cette grenouille ? Non seulement quel gâchis mais quel risque courrons-nous à nous enterrer dans des lieux que nous n’aimons plus, où nous ne nous sentons plus en sécurité et où les contraintes sanitaires revêtent un caractère rapidement insupportable ? Quel gâchis et quel risque courrons-nous à sacrifier à la sécurité d’un emploi, d’une activité plus ou moins intéressante, ce que nous pourrions mettre de bonheur supplémentaire dans notre vie ? Bien sûr, nous avons des besoins légitimes, des besoins fondamentaux avec lesquels compter, mais Manfred Max-Neef a montré qu’il y a bien plus de manières de les satisfaire que nous ne le pensons habituellement. Bien souvent, la tétanie qui s’empare de nous face à la perspective d’un changement tient à une forme d’aveuglement: un manque de connaissance de nous-même et de l’éventail des bonheurs différents dont nous sommes capables.
Il y a ce que l’on apprend à l’école et il y a les devoirs que la vie nous donne à faire sans nous avoir préalablement délivré les leçons. C’est pourquoi il nous arrive de tourner en rond dans des situations pourtant malsaines. Je sais de quoi je parle pour avoir jadis erré moi-même, et longuement, dans une pareille situation. C’est même cette expérience et la manière dont j’ai réussi à m’en libérer qui m’ont motivé à développer le parcours que j’ai baptisé Constellations. La crise sanitaire et sa gestion par les pouvoirs publics constitue, je le crois, la matière d’un de ces devoirs que la vie pose sur notre pupitre d'éternels écoliers.
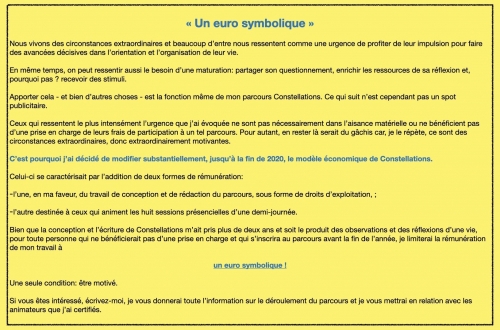
10:51 | Lien permanent | Commentaires (2)
30/08/2020
" Quand on aime ses proches "
« Quand on aime ses proches, on ne s’en approche pas trop ». Telle est l’une des antiennes que l’on peut entendre ad nauseam. Elle s'adresse aux jeunes et se complète du refrain qui ânonne que "neuf personnes sur dix qui décèdent du coronavirus ont plus de soixante-cinq ans".
Donc, une chose serait claire, les statistiques le montreraient et les discours l’affirment : à quelques exceptions près les jeunes ne représentent pas un danger pour eux-mêmes, ils en présentent un pour les vieux.
C’est pour protéger lesdits vieux que l’on généralise donc le port du masque: au bureau, à l’usine, dans les transports, au cinéma, au théâtre, à l’école, et même à l’air libre. C’est pour protéger les vieux que des millions de personnes ne peuvent plus se reconnaître dans la rue, se sourire, s’approcher et se toucher, se réunir, se distraire ou se cultiver. Bref que la nation toute entière se voit imposer une vie qui n’est plus qu’une survie.
J’ai soixante-douze ans. Cela signifie que je fais partie de la « population à risque ». Mais, avant d’écoper de cette valeureuse distinction, j’ai échappé à la première guerre mondiale (celle de mes grands-parents) ainsi qu’à la deuxième (celle de mes parents) et, de justesse, à celle d’Algérie. Au lieu de cela, j’ai connu les Trente glorieuses, le bond du pouvoir d’achat, la libération sexuelle, le plein emploi et les voyages au bout du monde. Pour résumer: la vie a été généreuse avec moi.
Et vous voudriez qu’après toutes ces faveurs, pour protéger ma vieille carcasse, j’accepte que l’on bride la vie de toute une nation ? Eh! bien, je préfère être mis en danger par des jeunes qui vivent leur vie plutôt qu’être l’alibi des restrictions qu’on leur impose.
Je vais vous dire ce que, selon, moi, on fait « quand on aime ses proches »: on prend le risque de les laisser vivre. Ce risque, en ce qui me concerne, avec mes soixante-douze berges, je l’accepte.
15:43 | Lien permanent | Commentaires (6)
24/08/2020
Le choc des récits
Je sais que je vais simplifier, et certains diront à outrance, mais je n’ai pas le désir d’écrire un traité, juste celui d’ouvrir une piste de réflexion. L’apparition de l’homme dans le processus de l’évolution des organismes vivants est celle d’un niveau particulier de conscience. Ce niveau de conscience aspire à donner un sens à sa présence au monde et cette aspiration engendre une multitude de spéculations qui prennent la forme de récits, genèses, aventures héroïques et apocalypses. Je considère qu’aujourd’hui, collectivement, nous assistons au choc non pas des civilisations mais des récits et singulièrement de deux grands récits qui balisent la bifurcation que nous avons devant nous. Quels sont-ils ces deux grands récits entre lesquels l’humanité va devoir choisir sa destinée ? D’une part le récit darwinien, de l’autre le récit évangélique.

Quand je parle du récit évangélique, je ne parle pas d’adhésion à une religion. Je me réfère seulement à l’histoire qui, au cours de deux millénaires, a irrigué d’innombrables âmes sincères. Je parle de la vie et de la prédication du Christ telles que l’Evangile les relate. Quant au récit darwinien, il s’agit du détournement opéré par Herbert Spencer et ses héritiers de la pensée de Darwin afin de transposer l’amoralité de la sélection des espèces à l’univers humain et social.
Le darwinisme social pourrait avoir pour devise le Vae victis - Malheur aux vaincus ! - de Brennus. Il considère que, selon les « lois de la nature » qu’il a retenues, l’aptitude à s’enrichir est un signe de supériorité et qu’à l’inverse l’échec appelle pour sanction la disparition pure et simple. Pour Spencer, la vigueur de la race humaine exige que l’on n’aide pas les perdants, les « riens » comme certains les nommeraient chez nous, car ce faisant on encombrerait de faibles et d’inadaptés l’élite de l’espèce. Vous imaginez un aigle dont l’envol devrait compter avec tous les ratés qui s’accrochent à ses pattes ? Atteindrait-il les cimes ? Pour la même raison, on ne doit pas empêcher, pénaliser ou limiter l’enrichissement, et pas davantage prendre en compte l‘éventuelle immoralité de ses moyens: dans la nature, la seule morale, c’est d’avoir le dessus. Si tu réussis dans cette jungle, tu accèdes à la légitimité, tout t’est permis et tu peux prétendre à diriger le monde. C’est ainsi, selon cette vision, que l’humanité est assurée de sa progression.
Le capitalisme néolibéral qui triomphe aujourd’hui est culturellement l’enfant de ce récit. Souvenons-nous que l’être humain a toujours besoin d’une caution et que, si elle n’est pas religieuse, elle doit avoir les apparences de la science. C’est ce que le récit pseudo-darwinien fournit aux passions humaines les plus archaïques que sont la richesse, le pouvoir, la jouissance sans entrave. Mais la différence entre les humains et les animaux est que ceux-ci sont limités dans leurs besoins alors que les appétits de notre espèce ne connaissent pas la satiété. Le résultat, c’est le monde que nous avons sous les yeux. La crise politico-sanitaire que nous sommes en train de vivre en a accusé les traits jusqu’à la caricature. C’est un monde régi par le cynisme, où le mensonge ne fait pas rougir, où la vérité est relative à l’argent que l’on touche et où la cruauté se purifie de raisons pseudo-économiques. Un monde où l’intelligence scientifique est empêtrée dans les générosités conditionnelles des sponsors de la recherche. Où la légitimité que confère la rapacité, avec pour corollaire le mépris des faibles, l’emporte sur toute autre considération. Où l’humanité peut sombrer dans la misère, l’abrutissement et l’asservissement, la planète dans la laideur et la pollution, pourvu que subsistent les oasis nécessaires au bonheur d’une toute petite élite. Celle qui le vaut bien.
A l’opposé de la réussite que le darwinisme social prend pour critère, l’histoire du Christ est celle d’une apparente déchéance. Jésus meurt piteusement sur la croix - ce supplice qui, selon les termes de Cicéron, est « le plus cruel et le plus infâmant qu’on inflige à des esclaves ». Or, cette mort est le premier apport du Christ au sein de l’histoire de l’humanité, le plus clivant, qui justifie à lui seul la remise à zéro du calendrier : il y a quelque chose de supérieur à la richesse matérielle, au pouvoir temporel, aux honneurs et même à la vie. Alain, l’incroyant, disait que la preuve de l’âme est la capacité de dire non, fût-ce, comme aurait pu compléter Pascal, au risque de se faire égorger. Force est de reconnaître que, résurrection ou non, une fois surmontée la sidération du calvaire, ce récit a parlé au coeur d’innombrables êtres humains au point que, plutôt que se renier, ils affrontèrent le supplice des arènes.
Le message évangélique donne à tous les humains une dignité égale. L’empathie originelle du christianisme pour les pauvres, renouvelée de siècle en siècle jusqu’à notre époque, montre à quel point il est radicalement inconciliable avec le darwinisme social. Pour le Christ et, si l’on a la foi chrétienne, pour Dieu, il n’existe pas d’individu dont la valeur intrinsèque serait augmentée par les possessions matérielles, les dignités mondaines, le pouvoir qu’il a su conquérir ou qu’il a hérités. On comprend que le christianisme soit plus ou moins discrètement détesté par une certaine élite: il en condamne les valeurs et les passions. Au jeune homme qui a gardé tous les commandements de la religion, Jésus propose, pour aller plus loin, de donner sa fortune aux pauvres ! Pis, à ceux qui lui demandent s’il faut payer l’impôt à l’Etat romain, il répond: « Rendez à César ce qui est à César ». Il nous dit que le sens et la joie de la vie ne sont pas à rechercher du côté du veau d’or mais d’une sobriété qui libère l’âme pour des fréquentations et des accomplissements d’un autre ordre. Au surplus, son message peut être considéré aujourd’hui comme écologique, puisque le bonheur auquel il invite est étranger à toute forme de prédation, de destruction ou d’excès.
L’apparition de l’humain dans le processus de l’évolution introduit un autre ordre que celui de la concurrence impitoyable, grossièrement recopiée des règnes animal et végétal, et c’est ce que la prédication du « Fils de l’Homme », malgré son ancienneté de deux mille ans, peut nous rappeler. C’était la conviction de Darwin qu’avec l’humain émerge un nouveau paradigme et c’est pourquoi il fut furieux du détournement de sa pensée commis par Spencer qui, de fait, sanctifiait en quelque sorte des mécanismes que notre espèce a pour destin de dépasser. Aujourd’hui, avec le transhumanisme, nous en sommes à vouloir augmenter l’humain alors que nous ne nous sommes pas encore appropriés tout notre potentiel.
Nous voici donc sur la ligne de partage des eaux. Chacun d’entre nous peut se demander auquel de ces deux grands fleuves affluent les récits qu’il se raconte. Celui qui nous mènera à parfaire la véritable évolution, celle où nos justes admirations ouvriront sur un nouvel avenir, ou bien celui qui nous entraînera rejoindre l’archaïque compulsion prédatrice dont l’achèvement sera la ruine et le chaos ?
16:42 | Lien permanent | Commentaires (3)


