08/02/2012
Et si on parlait de bonheur ?
Le monde change quand une majorité de gens décide d’être heureuse différemment. Comme l’a montré Alain de Vulpian dans A l’écoute des gens ordinaires, c’est la somme de ces choix non explicitement concertés mais dans certains domaines convergents qui, peu à peu, transforme la société. C’est comme une image dont les pixels se modifient, d’abord un à un, puis de plus en plus vite, pour composer un autre dessin que l’on découvre progressivement. C’est dans ce sens que, selon moi, l’usage du mot crise nous empêche de comprendre ce qui se passe réellement en nous enfermant dans une résistance malheureuse à ce qui est de l’ordre non d’un accident mais d’une métamorphose. La crise exprime les ultimes sursauts d’un monde que ses excès ont conduit au-delà de sa pertinence et au bout de sa course. Ce monde mourant devient le terreau d’un monde à naître.
La « société de consommation » dont nous avons commencé à payer le prix est l’expression d’un bonheur fondé prioritairement sur l’usage et la destruction de biens matériels. Elle est la compensation de périodes de précarité, de faim, de froid, de pénuries plus cruelles les unes que les autres qui ont hanté les hommes depuis la nuit des temps. Elle a pu se construire grâce à une combinaison singulièrement favorable de moyens de production et de ressources naturelles disponibles avec des politiques de répartition de la valeur ajoutée entre le capital, le travail et la société. Mais elle ne se serait pas développée sans la transformation progressive d’habitudes ancestrales qui nous incitaient à une prudente sobriété. Aujourd’hui, nous nous éloignons de plus en plus de cette combinaison qui a fait les Trente Glorieuses, mais les représentations de la réussite qu’elle a nourries ont une rémanence supérieure aux évènements. Je n’oserais en dire de même des représentations du bonheur, sauf dans quelques milieux privilégiés qui ne vont bientôt plus être que des îles au milieu de l’océan.
La société dont je crois qu’elle est entrée en agonie ne se caractérise pas seulement par le culte de la consommation et du gaspillage : c’est aussi une société d’individualisme. Les siècles passés, outre celles des pénuries, ont laissé la mémoire et la répulsion du contrôle de la vie personnelle par la vie collective. Au sein de celle-ci, les gens et leurs singularités pouvaient être niés et écrasés. Les décisions, au surplus, se prenaient au château – entendez-le au sens de Kafka –et elles avaient le caractère arbitraire de l’intérêt de quelques-uns s’imposant à l’intérêt de tous les autres. Comme l’illustre la fable de The Village*, l’on n’hésitait pas à recourir aux mythes pour encadrer une communauté et canaliser les individus. Le bannissement était donné comme la punition la plus redoutable : il vous livrait sans défense aux démons du dehors. Alors, à la faveur de la société de consommation, être soi plutôt qu’un reflet du groupe auquel on vous assimilait – qu’il s’agît de la famille, du hameau, de la classe sociale, du sexe ou du métier - est devenu une exigence. Jusqu’à la fatigue**que nous commençons à découvrir et jusqu’à ce que nous nous retrouvions presque tous, à un titre ou un autre, des bannis. Le bonheur par les avantages que procure la seule mécanique du marché est un bonheur éphémère.
Quand nous nous rendons à l’hypermarché, quand nous achetons sur la Toile, nous goûtons jusqu’à l’extrême la disparition des intermédiaires humains. Le peu de ceux-ci qui subsistent – aux caisses, au bout d’une improbable ligne téléphonique en cas de dysfonctionnements - est cantonné à des tâches qui les étiolent si manifestement qu’on les verrait disparaître avec soulagement. Pourtant, ici ou là, il arrive encore souvent que l’on cueille un sourire, d’une hôtesse de caisse ou d’un employé du gaz. J’ai eu récemment à faire rouvrir l’électricité dans un appartement. C’était une démarche que je n’avais pas eu à faire depuis des années. J’ai découvert avec agacement qu’il me faudrait être sur les lieux lors de la remise en service : une question de sécurité que j’ai bien comprise, mais j’aurais préféré que cela se réglât comme l’achat d’un DVD sur Internet, d’autant que la plage d’attente était quand même de cinq heures, ce qui est long dans un logement désert. Comme je tournais en rond dans l’appartement vide, on a frappé à la porte. Je me suis retrouvé devant un grand jeune homme – un mètre quatre-vingt-quinze pour le moins ! – au large sourire et à l’enjouement communicatif. La chose pour laquelle nous étions là lui et moi a été réglée en trente secondes, mais cette brève rencontre m’a laissé un souvenir durable. J’ai pensé au passage de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran***, quand le héros découvre la puissance du sourire. Certes, grâce à la grande distribution, nous n’avons plus à compter avec les états d’âme du petit épicier de notre enfance, qui n’avait qu’une marque de bonbons et qui, en fin de journée, était parfois à court de poireaux ou de salades. Nous n’avons plus à lui faire la conversation, ou plutôt à échanger de ces banalités qui nous paraissaient stupides. Nous sommes protégés aussi de ces agents de la rumeur cancanière qu’étaient tous ces petits commerçants d’un village, postés au long de nos courses jadis. Nous gagnons du temps pour faire les choses qui nous importent, fréquenter les gens que nous avons choisi de fréquenter et, tels des ombres, nous passons partout dans l’anonymat.
(à suivre)
* The Village, film de Night Shyamalan, 2004.
** La fatigue d’être soi, Alain Ehrenberg, éditions Odile Jacob, 2008.
*** Eric-Emmanuel Schmidt.
UN CHOIX DE CHRONIQUES EXTRAITES DE CE BLOG A ETE PUBLIE
PAR LES EDITIONS HERMANN
SOUS LE TITRE: "LES OMBRES DE LA CAVERNE"
08:03 | Lien permanent | Commentaires (4)
22/01/2012
Oser déplaire
Je vois que, parfois – et trop souvent à mon goût – certains histrions de la politique se recommandent de Charles de Gaulle. Pour mes lecteurs assidus, il n’y a pas de mystère, je suis un admirateur de l’Homme du 18 juin. Je ne reprocherai pas à ceux qui n’ont pas eu de circonstances historiques exceptionnelles pour se révéler de ne pas réussir à se hausser à sa hauteur. Ce que je ne supporte pas, en revanche, c’est qu’on se réclame de lui à tort et à travers et sans en incarner les valeurs personnelles.
De Gaulle a été tout ce qu’on veut sauf un réaliste à la mode d’aujourd’hui, ce réalisme dont on nous bassine et qui est très proche de celui de Philippe Pétain. Le réalisme d’aujourd’hui, comme celui de la débâcle de 1939, consiste à courber l’échine devant la « force des choses » et à honorer des lois qui ne reflètent que l’idéologie et l’arbitraire des plus forts ou des plus malins. Ce réalisme revient à s’enfermer dans ses problèmes et, d’une certaine manière, à considérer que ce qui nous arrive est le prix de nos péchés. La France n’est pas assez compétitive, elle se fait battre, et c’est la faute des Français qui sont paresseux, c’est la faute des congés payés ou des 35 heures, c’est la faute de notre système social dispendieux, de notre déni des valeurs véritables que sont l’ordre, l’obéissance et le travail. Regardez l’Allemagne : malgré le poids du traité de Versailles, elle s’est relevée, musclée, armée ! Malgré la réintégration de la RDA, elle est aujourd’hui le pays fort de l’Europe. Allez, pauvres Français, battez votre coulpe, ce qui vous arrive, vous l’avez mérité et pour vous en sortir, acceptez qu’on vous étrille !
A la différence de ces prophètes de l’abaissement, au milieu de la débâcle de 39 Gaulle reste persuadé de la grandeur de la France et se comporte comme tel. Il a cette première valeur, le courage, dans laquelle on reconnaît le mot cœur, et qui n’a rien à voir avec l’agitation, les coups de gueule, les rodomontades de nos professionnels de la petite phrase et du froncement de sourcil. Il est plus facile de dire qu’on reste droit dans ses bottes que de le rester. Le vrai courage, l’intelligence supérieure, c’est d’abord de croire grand et d’être fidèle à ce que l’on croît, même et surtout quand un monde s’effondre. Il s’agit de voir grand, il s’agit aussi de voir large. Quand Pétain constate – et consacre - l’impuissance d’un pays vaincu, démoralisé de sa défaite, de Gaulle voit au-delà des limites du moment, il voit les ressources qui subsistent et celles qui naîtront demain de l’évolution de la situation. « La France n’est pas seule » martèle-t-il le 18 juin 1940. Et d’évoquer le vaste empire et la dérive du conflit européen vers une dimension planétaire.
Alors, techniquement, je ne sais pas ce que de Gaulle ferait dans la souricière financière et économique où nous nous retrouvons. Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il serait mû par cette certaine idée de la France qui ouvre ses Mémoires de Guerre et qu'il ne s'embarrasserait pas de l'opinion de ceux qui ne veulent pas notre bien. Il pourrait proposer une voie difficile – celle de la Résistance ne l’était-elle pas ? – et ne promettre d’abord, comme Churchill le fit alors pour les Anglais, que « du sang et des larmes ». Il pourrait proposer une voie qui heurte certaines conventions - et on entendrait comme jadis coasser les grenouilles. Au mépris de ce qu’on pense à Carpentras, à Washington, dans les dîners en ville ou les agences, il choisirait ce qui est bon pour la France et les Français, avec même un certain plaisir à voir « tout ce qui grouille, grenouille, scribouille ». Mais nul doute que ce chemin le moins fréquenté – pour reprendre un titre de Scott Peck - serait plus fécond que l'agenouillement permanent et docile devant les agences de notation. Tout finit sans doute par la technique, mais tout commence par la posture et en dépend, y compris l’intelligence d’une situation.
Billevesées que ce que je viens d’écrire ? Il y a pourtant un pays, en ces temps de misère, qui a choisi, avec un culot que certains ont jugé obscène, ce chemin le moins fréquenté, un chemin qui, comme souvent, n’est pas celui de la conformité et du souci du qu’en-dira-t-on. Il s’agit de l’Islande. On se souvient combien ce pays, qui bénéficiait du fameux triple A, est tombé bas quand l'incendie des subprimes a révélé les errements de son système bancaire. À la fin de 2008, l’Islande était endettée à hauteur de neuf fois son PIB, sa monnaie s’effondrait et, après une baisse de 76%, la Bourse cessait ses cotations. Que s’est-il passé ensuite ? Les citoyens d’Islande - des terroristes, en vérité - ont refusé par référendum que leur pays sauve les banques privées. Ils en ont laissé froidement s’écrouler quelques-unes et ont envoyé au tribunal une poignée de leurs dirigeants, sans parler de quelques hauts-fonctionnaires. Glitnir, Landsbankinn et Kaupthing ont été nationalisées et placées sous contrôle démocratique au lieu de bénéficier, comme on l’a fait ailleurs, d’injections financières sans contrepartie qui permettent maintenant aux secourus de dévorer la main qui les a sauvés.
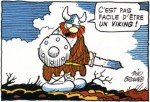 En faillite, l’Islande a reçu des prêts du FMI, des pays nordiques et de la Russie. Le FMI, qui ne vide pas sa bourse comme cela, a exigé des coupes sombres dans le budget de l’Etat. Les citoyens, alors, se sont révoltés, provoquant des élections anticipées et renvoyant au purgatoire de l’Histoire le parti conservateur qui ne méritait plus guère son nom de « parti de l’indépendance ». Le nouveau gouvernement a réuni une assemblée constituante composé de « citoyens ordinaires » pour amender la loi organique et a soumis deux fois à référendum le paiement par l’Etat islandais des dettes contractées par les banques du pays. Les Islandais, deux fois, ont voté contre. Des voyous vous dis-je! Depuis lors, les créanciers piaffent et les agences de notation, évidemment, exercent des pressions, mais sans grand succès : cette engeance insulaire est stupide à un point inimaginable ! Quant aux médias européens, vous avez pu vous en rendre compte, ils se contentent d’évoquer cette histoire avec discrétion, comme une anecdote malsaine. Quel mauvais exemple donnent ces descendants de Vikings! Qui sait où ils nous conduiraient si d’autres peuples décidaient de les imiter ! Ma pauvre dame, nous vivons vraiment une drôle d’époque!
En faillite, l’Islande a reçu des prêts du FMI, des pays nordiques et de la Russie. Le FMI, qui ne vide pas sa bourse comme cela, a exigé des coupes sombres dans le budget de l’Etat. Les citoyens, alors, se sont révoltés, provoquant des élections anticipées et renvoyant au purgatoire de l’Histoire le parti conservateur qui ne méritait plus guère son nom de « parti de l’indépendance ». Le nouveau gouvernement a réuni une assemblée constituante composé de « citoyens ordinaires » pour amender la loi organique et a soumis deux fois à référendum le paiement par l’Etat islandais des dettes contractées par les banques du pays. Les Islandais, deux fois, ont voté contre. Des voyous vous dis-je! Depuis lors, les créanciers piaffent et les agences de notation, évidemment, exercent des pressions, mais sans grand succès : cette engeance insulaire est stupide à un point inimaginable ! Quant aux médias européens, vous avez pu vous en rendre compte, ils se contentent d’évoquer cette histoire avec discrétion, comme une anecdote malsaine. Quel mauvais exemple donnent ces descendants de Vikings! Qui sait où ils nous conduiraient si d’autres peuples décidaient de les imiter ! Ma pauvre dame, nous vivons vraiment une drôle d’époque!
A ce tableau rapidement brossé, il manque une dernière touche : la croissance économique de l’Islande est de 2,1% pour 2011 et elle devrait être trois fois celle de l’Europe en 2012. Grâce, principalement, à la création d’emplois.
Dans Scènes de la vie conjugale, le film d’Ingmar Bergman, la femme qu’incarne Liv Ullman se rend compte soudain qu’elle a perdu sa vie à vouloir faire plaisir aux uns et autres. Avoir la responsabilité d’un pays et d’un peuple est une chose trop sérieuse pour être ramenée à cela. Quels que soient les dieux ou les mortels dont on aimerait être reconnu. Je ne dis pas que nous devons suivre l'exemple des Islandais. Je dis juste qu'il vaut mieux guérir hors des normes que mourir dans les normes.
http://www.pressegauche.org/spip.php?article9031
UN CHOIX DE CHRONIQUES EXTRAITES DE CE BLOG A ETE PUBLIE
PAR LES EDITIONS HERMANN
SOUS LE TITRE: "LES OMBRES DE LA CAVERNE"
00:49 | Lien permanent | Commentaires (7)
05/01/2012
Ceci n’est pas une crise
Nous savons que 2012, à peine commencé, aura une fin. Cette nouvelle orbe amorcée hier par la Terre se rebouclera sur elle-même et, alors, tout aura pris un an de plus. Tout ce qui a un commencement tend vers une fin. Tout ce qui est né mourra. Dans l’habitude des jours, beaucoup de choses nous paraissent devoir durer éternellement. Cependant, il n’en est rien. L’entropie est la loi de ce monde. Les empires, les religions et les civilisations passent. Même les étoiles meurent comme les hommes. Nous concernant, Teilhard de Chardin parlait de ces « passivités de diminution », ces affaiblissements qui, plus ou moins tôt, plus ou moins progressivement, s’emparent de nos organismes - et voilà que les yeux voient moins bien, que le cœur fatigue, que l’anarchie s’empare de certaines cellules, que la désorganisation s’introduit en nous, et nous sommes de moins en moins maîtres en notre demeure jusqu’à ce que la vie elle-même vacille et, finalement, nous échappe.
Les entreprises connaissent aussi cette loi, dont ont pourrait penser que, du fait du renouvellement des hommes, elles seraient affranchies. Le Club des Hénokiens, qui rassemble des compagnies de plus de deux cents ans et qui sont restées détenues à cinquante pour cent au moins par la famille fondatrice, ce club ne compte guère qu’une quarantaine de membres de par le monde. Vous me direz que la règle de la possession familiale introduit un biais et que tant la vie que l’identité d’une entreprise ne tiennent pas davantage à ses propriétaires qu’à ses salariés. Ceux-ci et ceux-là peuvent se renouveler du moment que l’entité économique perdure. Or, même la quête de l’excellence ne lui garantit pas une longévité supérieure à la vie d’un homme. Elle reste, en moyenne, très inférieure. En vingt ans beaucoup d’entreprises, qu’on donnait en exemple et dont on modélisait la stratégie dans les cours de management de Harvard et d’ailleurs, ont été effacées des tableaux d’honneur établis par les consultants américains.
Alors, de même qu’on dira, lorsqu’un décès est survenu : « S’il n’était pas sorti ce matin-là, s’il n’avait pas pris sa voiture, s’il s’était mieux couvert, etc. », de même pour une entreprise on invoquera un accident malheureux, un évènement qu’on voudra considérer comme exogène : l’erreur d’un vieux chef, un retournement de conjoncture, une rupture technologique, la trahison d’un banquier… Bref, d’une certaine manière l’injuste fatalité ou la « faute à pas de chance ». Finalement, c’est comme si on mourrait toujours d’un accident d’autant plus malheureux qu’il semblera ensuite qu'on aurait pu l'éviter. Mais l’accident, dirai-je, pour extérieur qu’il soit, fait souvent partie de l’entropie. Son caractère aléatoire est un déguisement dont nous affublons la Parque. Nous n’aimons pas penser que le processus de désorganisation est en nous et nous aimons encore moins penser que la mort, de toute façon, même pour Jeanne Calmant, est qu’on le veuille ou non au bout du chemin.
De tels évènements, à la vérité, annoncent l’épilogue d’une histoire. Lorsque l’excellence manifestée jusque là de manière continue par une entreprise dans un de ses domaines de prédilection est trahie par des accidents, ces accidents sont les craquements d’une fissure qui s’ouvre. On calfatera peut-être, sans en sonder la vraie profondeur – souvent, d’ailleurs, sans oser le faire.
Une entreprise qui dure, c’est une entreprise qui a su établir avec l’environnement un couplage positif et elle ne peut durer qu’autant que ce couplage reste avantageux pour elle et pour l’environnement. A l’intérieur, l’entreprise doit maintenir ce qui permet à ce couplage de s’ajuster en permanence. Si l’environnement change, il faut que, du capitaine aux soutiers, tout le monde soit prêt à infléchir la course du navire. L’apparition du gaz et de l’électricité change le paysage des fabricants de bougie. L’apparition de la photographie numérique change le paysage des fabricants de film argentique et des appareils qui les utilisent. C’est dans cette histoire, mille fois répétée dans les secteurs les plus variés, qu’on voit les différents niveaux de manifestation de l’entropie. L’entropie qui, si on prend un peu de recul, si l’on accepte de tant soit peu lâcher prise, est en fait l’amorce d’une métamorphose.
Le poisson pourrit par la tête, disent les Japonais. En l’occurrence, le conseil d’administration de Kodak, alerté des premiers pas de la photographie numérique, a traité cette information par le dédain. L’intelligence de l’entreprise, ankylosée par son succès et par sa position dominante, s’est grippée. Un grippage qui, pour Kodak, a précédé de quelques mois seulement la descente aux enfers. Mais de quoi est faite l’intelligence de l’entreprise ? S’agit-il de son président-directeur général ? S’agit-il de son comité de direction ? S’agit-il des membres de son conseil d’administration ? Dans la mesure où c’est bien dans le jeu entre ces instances que se situe la gouvernance de l’organisation, il s’agit de tout cela ensemble, et, à l’instar des neurones au sein du cerveau, des interactions qu’elles ont entre elles. Quand Kodak se gausse des informaticiens qui prétendent concurrencer la photographie argentique, le grippage est bien là. Le découplage d’avec l’environnement, quels qu’en soient les signes, n’est pas un accident. Il ne doit pas être analysé comme une simple erreur. C’est un signe de vieillissement. Et vous remarquerez que, dans ces cas-là, on va s’entêter à faire et refaire toujours de la même chose bien que l’environnement renvoie toujours le même refus. Les entreprises sont comme les hommes, quand la vieillesse les atteint, d’abord elles rabâchent, puis, finalement, elles radotent.
Il est un autre registre du vieillissement. Je me souviens d’un homme politique qui me disait jadis, lors d’une campagne électorale, alors que j’étais un adolescent quelque peu entier dans ses convictions : « Si on veut gagner, on ne peut pas s’opposer à tout le monde ». Dans le couplage avec son environnement comme dans la gestion de ses hétérogénéités internes, l’entreprise peut générer des frustrations, des griefs, des rancœurs. Cela semble inévitable. Cependant, si on les traite par le mépris, voire si on s’amuse - comme je l’ai vu faire parfois - à les exciter, ils peuvent être les précurseurs de l’entropie. Susciter des oppositions, c’est un processus à la fois naturel et dangereux, un peu comme la production de cholestérol : c’est une question de quantité et il y a le bon et le mauvais. Si on n’y prend garde, à se déposer dans les artères le mauvais peut les encombrer mortellement. Il viendra un moment où vos adversaires, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur, seront trop nombreux. Vous sentirez que les choses tendent à vous échapper. Les ratées, les escarmouches, les inerties consommeront de votre énergie, la détournant ainsi de sa fonction créatrice. Vos adversaires peuvent juste être des gens qui, un jour, sans se révolter, décideront simplement de vous laisser courir à votre perte. S’il s’agit de vos employés, ils peuvent se contenter de ne plus tendre vers l’excellence, quelles que soient les menaces ou les promesses que vous leur ferez. Cette accumulation progressive d’inerties et de forces contraires, que l’on suscite et développe soi-même par ses comportements, est l’autre grand facteur de grippage des organisations humaines. C’est comme si, un jour, tout le monde, et la Terre même, étaient las de vous supporter.
Enfin, parfois, on est aussi la victime de ce qu’on a voulu trop fort. Vous avez voulu n’avoir que de bons petits soldats, des rouages, qui exécutent sans se poser de question, et un jour vous vous plaindrez d’être entouré de zombies. Vous avez voulu qu’on vous craigne, et vous n’aurez personne pour vous dire la vérité si vous êtes susceptible de mal la prendre. Vous avez voulu tout ramener au mesurable, et vous n’aurez plus que ce qui s’achète. Vous avez voulu que la moindre décision passe par vous, et vous vous retrouvez congestionné de tout ce que les gens ont peur d’arbitrer eux-mêmes. Je me souviens d’un directeur général qui me disait, deux ou trois ans avant de passer le relai : « Je travaille à organiser mon inutilité ». Si les entreprises ne survivent pas aux hommes comme, logiquement, elles en ont la capacité, c’est que cette sagesse est rare. L’entropie des hommes est contagieuse.
Je disais que l’entropie vient à bout de tout. Vous acquiescez parce que vous connaissez l’Histoire : le monde égyptien, le monde hellénique, le monde romain ont passé. Le cimetière des civilisations est immense. Alors, libérons-nous de l’idée que la nôtre, avec nos croyances et nos modes de vie, pourrait bénéficier d’un passeport pour l’éternité. Ce que nous vivons n’est pas une crise. C’est une métamorphose. L’explosion des subprimes et l’écroulement des dominos qui s’en est suivi – et qui n’est pas fini - ne sont que l’accident dont on pensera que, sans lui, l’ancêtre aurait pu concurrencer Mathusalem. Ma conviction est qu’un autre monde est en train de se lever à l’horizon.
UN CHOIX DE CHRONIQUES EXTRAITES DE CE BLOG A ETE PUBLIE
PAR LES EDITIONS HERMANN
SOUS LE TITRE: "LES OMBRES DE LA CAVERNE"
11:28 | Lien permanent | Commentaires (3)


