12/02/2012
Evolution
J’entendais un dimanche sur ma radio préférée qu’à écouter de la musique notre oreille évolue et que, de ce fait, nos goûts évoluent aussi. Si l’on transpose cela dans le domaine de la peinture, force est de reconnaître que, par exemple, la photographie a fait évoluer l’art de fixer par le pinceau l’apparence des choses et des êtres. Monet, à son tour, a fait évoluer notre manière de voir et de percevoir les couleurs d’un paysage. De même de l’alimentation et de la dégustation des vins : plus on prête attention aux saveurs, plus on fait émerger de l’amalgame initial des sensations celles qui nous ravissent. J’ai oublié l’auteur de cette phrase lue un jour quasiment par hasard : « Progresser, c’est apprendre à faire de plus fines et plus nombreuses distinctions ». Faire des distinctions plus fines et plus nombreuses appelle à aller plus loin. Alors, pourquoi s’étonner que nos représentations de la réussite, du bonheur, de la bonne manière de vivre puissent évoluer ? Il ne fait aucun doute pour moi qu’une majorité d’humains, aujourd’hui, souhaite - après l'avoir aimé - un autre monde que celui dans lequel nous vivons.
J’évoquais dans ces chroniques une intervention de Barry Schwartz sur le paradoxe du choix : nous avons souhaité avoir à notre disposition davantage de choix et, aujourd’hui, pour la plus insignifiante des décisions, nous avons tant d'options possibles que nous gaspillons notre temps et notre énergie à les comparer, sans avoir même, au bout du compte, la sérénité d’avoir elu la meilleure. Nous avons aussi souhaité jouir de plus de biens manufacturés. Résultat : l’industrie ne cesse de nous noyer sous ses productions de toute sorte. Il y a un conte africain où Guinarou, un mauvais génie, sous prétexte d’aider un malheureux, le tyrannise et le torture. La piqûre d’un moustique le démange-t-elle ? Aussitôt, Guinarou et ses serviteurs viennent le gratter. Mais ils le grattent jusqu’à l’os ! A-t-il faim ? Ils le gavent comme une oie jusqu’à ce qu’il explose. Pleure-t-il ? Ils se mettent à pleurer avec lui au point qu’il se noie dans une inondation de larmes.
Au vrai, Guinarou semble avoir pris les commandes de notre monde. Nos objets, leur production, leur usage et leur destruction finale consument notre existence. Nous commençons à nous en rendre compte. Quand, dans son salon à roulette, on se voit pour la millième fois avancer moins vite qu’un cycliste, voire qu’un piéton, quand au surplus on y dépense de plus en plus d’argent et d'énergie nerveuse, on se demande quelle est la pertinence d’un véhicule de plus d’une tonne pour transporter un être de 60 ou 80 kilos! Quand, ayant réuni une poignée de ses semblables, on les voit consulter plus ou moins discrètement leurs messagerie et prendre les appels qui se présentent sur leurs cellulaires, on se fait la même réflexion que mon ami Hervé Gouil : « Voilà des objets censés rapprocher ceux qui sont loin mais qui éloignent ceux qui sont proches ». Quand on se retrouve à perdre en transports les heures qu’on a gagnées sur le temps de travail, l’écureuil dans sa cage tournante devient notre frère. Nous avons des voitures rapides qui n’avancent pas, plus de DVD que nous n’avons le loisir d’en regarder, de disques que nous n’avons le temps d’en écouter et de nourriture que nos ventres ne peuvent en digérer*. Nous avons voulu nous libérer des corvées de production et nous avons réussi : tant de temps libéré a tourné en chômage, en inutilité sociale, en anomie. Au surplus, tous ces produits de notre activité productive, non contents de squatter notre temps, viennent concurrencer ces biens essentiels que sont la beauté et la santé de notre milieu de vie. Ouvrez les yeux, les oreilles, respirez, et dites-moi, là où vous vous trouvez en ce moment, si vous ne percevez pas le moindre effluve de pollution chimique, visuelle, auditive, olfactive, aérienne…
On peut dire que nous, Occidentaux, nous avons exploré jusqu’à ses confins une forme de civilisation, nous en avons goûté les douceurs et nous sommes en train d’en découvrir l’amertume et les poisons. Mais nous avons aussi, en même temps, découvert ou redécouvert d’autres saveurs dont notre vie pourrait s’enrichir. Je pense par exemple à la lenteur qu’évoque Sylvie Pouilly dans Commencements 1**. Je pense à Bernard Ollivier et à cette toute simple activité qui peut mener littéralement si loin, occuper tant de jours, remplir les yeux de tant de choses et la vie de tant d’expériences : la marche, tout simplement. Je pense à Rob Hopkins et à ses amis de Totnes Transition Town, qui se placent dans une perspective à trente ans et sèment des fleurs, des légumes et des idées partout où ils peuvent germer et grandir pour préparer la civilisation de l’après-pétrole. Je pense à mes amis Béatrice et Gérard Barras et, parmi toutes leurs réalisations, à leur chantier du Viel Audon où tant de jeunes ont appris le contact de leurs mains avec la matière et le précieux accomplissement d’édifier quelque chose de simple et de sain dans la fraternité***. Tant d’autres encore que je n’ai pas la place de citer… Les saveurs du monde de demain sont déjà là.
* 40% de gâchis dans nos poubelles)
** www.co-evolutionproject.org
*** Cela c’est pour la prochaine livraison de Commencements. Il faudra attendre le printemps !
15:20 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/02/2012
Pour l'instant, ô ma soeur, pour l'instant...
« Il ne faut pas que cette histoire se répande, dit la sorcière Solitude.
- Ceci n’est qu’un conte, la rassura sa sœur Imposture, un petit conte de rien du tout. Nous avons les moyens de le rendre insignifiant, de l’étouffer dans l’œuf, de le ridiculiser. C’est un combat dérisoire, gagné d’avance.
- N’empêche que même un conte peut nous faire du tort. De plus en plus de prisonniers secouent leurs chaînes, se rassemblent, se mettent à parler entre eux. Il y a de nombreux exemples où des chansons, des mythes locaux ou des légendes populaires se sont mis en travers de notre route.
- Nous les avons toujours muselés, mis à l’index, lapidés, déclarés pathologiques ou impies, nous avons toujours vaincu.
- Pour l’instant, ô ma sœur, pour l’instant…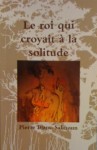
http://www.cooprh.com
08:05 | Lien permanent | Commentaires (1)
10/02/2012
Et si on parlait de bonheur ? (suite et peut-être fin)
Mais voilà… Cette société que nous avons construite de nos choix a évolué de telle sorte qu’elle est en train devenir la société de pénurie que l’on croyait fuir en se jetant dans ses bras. Elle a évolué de telle sorte que l’individu libre et maître de son destin connaît aujourd’hui les effets de cette vieille maxime des hommes de pouvoir : « diviser pour régner ». Sur le divin marché, il y a davantage de choix - quand on a de l’argent. Il n’y a plus de communauté possessive et enfermante - mais il n’y a pas non plus de protection du faible face au fort. La communauté nationale elle-même s’est dissoute dans les mécanismes de l'omnipotent marché, abandonnée qu’elle a été par ceux qui étaient censés la représenter et en assurer l’existence et la cohésion. Illusion, paresse, complicité ? Les hommes et les femmes d’Etat ont choisi le moins d’Etat. Alors, en cet hiver 2011, nous voilà, par exemple, revenus aux débuts de l’abbé Pierre. L’individu d’aujourd’hui n’est libre et maître de son destin qu’à l’instar d’une coquille de noix jetée sur un océan où les dieux décident des vents, des courants et des tempêtes. La finance mondiale, selon ses oscillations, fait et défait les pays et les entreprises avec les peuples qui dépendent d’eux. Le lobbying insidieux des multinationales, parfois assorti de prévarication, promeut telle loi ici, telle dérégulation ailleurs, afin de substituer aux droits les plus élémentaires de ces mêmes peuples les projets d’une ploutocratie mondiale. Les grands pollueurs et les grands empoisonneurs ont d’abord une activité liberticide.
Cette société est aussi une société de prédation et de concurrence de chacun contre tous. L’appauvrissement rampant des pays qui ont dominé le monde y a été compensé et masqué par des marchandises produites ailleurs dans des conditions dont nous ne voudrions pas pour nous-mêmes. Comme nous tenons à garder notre bonne conscience, nous nous sommes persuadés que c'est là pour ces nouveaux esclaves la voie vers les lendemains qui chantent. Une partie des Terriens est devenue la serve des besoins et des fantaisies de l’autre partie. Une partie des surfaces de la planète a été enlevées aux cultures vivrières locales, à la biodiversité et aux peuples premiers qui les habitaient pour satisfaire notre gourmandise, nourrir nos animaux et alimenter la folie de transports. La raréfaction des emplois sur le marché du travail est en train de faire de l’homme, selon la vieille formule latine, un loup pour l’homme. Cette concurrence se transpose à l’intérieur de certaines entreprises où survivre et protéger ses avantages acquis devient, plus que la production de biens ou de service, l'activité quotidien. Des consultants et des dirigeants nous expliqueront que seule la concurrence et le risque de perdre ce que l’on a permet aux individus de donner le meilleur d’eux-mêmes, et que rester à flot sur les lames de la mondialisation est à ce prix. J’ai même connu un chef d’entreprise, déjà dans les années 80, qui prônait et suscitait artificiellement cette atmosphère de menace permanente afin que ses cadres « ne s’endorment pas ».
Le détournement et la récupération idéologique des concepts de Darwin ont donné une teinture scientifique à la ré-institution de la loi de la jungle qui a fait irruption dans nos sociétés comme une bande de loups affamés dans un village. Mais cette école de la concurrence est aussi, paradoxalement, une école de courtisans, de discipline et de soumission. La liquidation, par les pouvoirs publics, de l’Ecole Mutuelle que présente mon ami Marc Tirel dans le numéro 2 de Commencements*, révèle que le souci des politiques du XIXème siècle n’était pas d’éduquer des citoyens responsables mais de produire des ouvriers bien dressés. Lorsque la compétition n’est pas un fait de nature mais est organisée par les maîtres, le résultat est un hybride étrange. Il faut être le meilleur gladiateur, mais, en même temps, il reste inconcevable de secouer le cocotier d’où le pouvoir organise et surveille les jeux de cirque. Résultat : au sein des organisations on devient prédateur de ceux qui sont « en dessous » et courtisans de ceux qui sont « au dessus » et nous avons, du haut en bas de la pyramide, une cascade de concurrences. Il faut entendre les conversations dans le métro et le RER ou au restaurant, quand elles évoquent les relations de travail, pour se faire une idée de l’étendue des pathologies de la « performance ». Voilà donc notre individu libre et maître de son destin finalement rien moins qu’affranchi.
Alors, la somme de cet ensemble de disharmonies et de déceptions, c’est que vient un moment pour certains où, à travers le fameux « boulot, métro, dodo », la question du bonheur commence à s’insinuer. « J’ai tout ce dont on m’avait dit dans mon enfance que cela constituait le bonheur. J’ai parfois les moyens de dire oui sans réfléchir aux saltimbanques hallucinés des clips publicitaires qui me proposent la planète du bonheur pour peu que j’achète telle marque de chocolat, de lessive ou de voiture. Mais j’ai l’impression, de plus en plus, que cela a un coût. Non pas en argent, mais dans mon économie intime. Et si je n’ai pas les moyens de craquer de temps en temps pour le dernier téléphone portable ou si je dois me restreindre sur tel ou tel produit, je me sens frustré, amer, malgré tout ce que j’ai déjà. En outre, je suis obligé de me battre pour conserver un emploi qui m'use et où je perds le sens de ma vie**, qui me permet seulement d’accéder à ces biens dont la consommation me déçoit et dont la privation me frustre. J’ai honte de me poser la question, mais : suis-je heureux ? »
Se poser cette question, c’est ouvrir un champ vertigineux. C’est s’apercevoir éventuellement, comme le personnage de The Truman Show***, que nous sommes les marionnettes d’une comédie du bonheur. Cette comédie du bonheur n’est pas sans me faire penser au conte d’Andersen : Le roi est nu. En fait, des filous de tailleurs nous ont fait croire, et continuent de nous faire croire, qu’ils nous habillent de félicité. Mais nous sommes nus. Nous sommes nus, mais nous sommes aussi, tous, des rois. A nous de tisser dès maintenant l’étoffe d’autres bonheurs et le monde changera.
* www.co-evolutionproject.org
** Cf. par exemple parmi les articles récents: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/4961f094-534e-11e1-89d8-a...
*** The Truman Show, de Peter Weir, 1998.
08:05 | Lien permanent | Commentaires (2)


