25/03/2020
Du confinement comme initiation
Sur le site des Errances Narratives (1), un article d’Elizabeth Feld, un peu technique mais que j’ai trouvé électrisant, propose de voir le confinement que nous vivons comme un passage, un rite initiatique. Pour ceux qui peut-être les découvrent ici, je dirai - en simplifiant certes beaucoup - que, selon les Approches narratives, « plus que ce qui nous arrive, ce qui compte est ce que nous nous racontons à propos de ce qui nous arrive ». En l’occurrence, nous inviter à voir un passage ou un rite initiatique dans le confinement que nous imposent les Pouvoirs Publics ne peut que rendre féconde une période qui, pour le moment, est dominée par un récit de peur, de perte et de frustration. Pour beaucoup de gens, me semble-t-il, la seule attente est celle d’un retour au statu quo ante. D’une part, il y a selon moi beaucoup d’illusion dans cette attente; d’autre part, je pense que l’on peut mieux faire que passer notre confinement à ne souhaiter rien d’autre que ce retour en arrière. C’est pourquoi transformer cette période inattendue que nous sommes obligés de vivre en un passage ou un rite initiatiques est la garantie de tirer de notre liberté étroitement cantonnée une miraculeuse valeur ajoutée. J’avertis ici tout de suite mes lecteurs que j’écris au fur et à mesure que je pense, voire que j’écris pour penser. Je tâtonne pour essayer de m’approprier le mieux possible une idée qu’à peine découverte j’ai adoptée, embrassée même, intuitivement. Je ne suis pas anthropologue ni même spécialiste des Approches narratives: je ne suis qu’un touche-à-tout autodidacte qui, en l’occurrence, tente d’enrichir sa vie d’une métamorphose qu’on lui propose comme un cadeau.
S’agissant des caractéristiques des rites initiatiques, ce qui me vient d’abord à l’esprit, c’est évidemment le retrait. Le retrait, la mise entre parenthèses, est un moment plus ou moins long selon les cultures et les circonstances, mais c’est toujours un moment de vie soustrait à l’habituel, au banal, à l’ordinaire. Il me revient soudain d’avoir déjà « fait retraite »: c’était l’année de mes douze ans. Fils de familles chrétiennes et catholiques, on nous isola deux jours dans un lieu pour nous inhabituel - le collège des filles, seul établissement de la ville tenu par des soeurs - en prévision de notre communion solennelle. Le retrait que demande le rite initiatique a donc pour objectif une préparation. Une préparation, pourrait-on dire, à ce qu’est une vie pleine, une vraie vie, dans une culture singulière qui lui en fournit la référence. Mais pourquoi se retirer, se retrancher ? Il me semble qu’une des dimensions du retrait est, comme le chabatt, le Jour du Seigneur ou les jours fériés de l’Antiquité, de signifier qu’il y a quelque chose de plus grand que nous, un ordre supérieur à notre petit monde affairé et à nos passions ordinaires. Il est d’ailleurs significatif que notre société matérialiste trouve encombrantes ces coutumes d’un autre temps comme le repos dominical: elles ralentissent la machine à produire et consommer qui est devenue la divinité de ce monde.
Alors, dans notre confinement actuel, quel est ce plus grand que nous, cet ordre supérieur, vers lesquels nous devrions nous tourner, auxquels nous devrions ouvrir notre esprit et notre coeur ?
◊
Dans les traditions dont mes lectures m’ont laissé le souvenir, le rite initiatique utilise la perturbation des repères spatio-temporels. C’est bien ce qu’induit notre confinement en nous privant d’une grande partie des points d’appuis que sont nos habitudes, nos perceptions coutumières, le rythme de nos jours ordinaires, et en nous mettant face à des places désertes, à des rues devenues aveugles de leurs commerces clos, à des rayons et des étals dégarnis, à des lieux de convivialité interdits. En nous faisant croiser, sur le chemin de la boulangerie, des gens qui rasent les murs, masqués, les yeux ailleurs à moins qu’ils portent en biais, les uns sur les autres, un regard de crainte qu’accompagne parfois un soupçon de détestation. C’est que, dans ce cauchemar sans drogue, par virus interposé, l’autre peut devenir mon assassin autant qu’à mon corps défendant je peux devenir le sien. Perdus au milieu d’un vide artificiel peuplé d’un ennemi invisible, nous faisons l’expérience du sentiment de vulnérabilité et de ses dérives.
Qu’avons à apprendre de nous, quand nous sommes ainsi sous la pression d’une situation extravagante ?
◊
Le rite initiatique, aussi, est un moment qui marque un avant et un après. C’est qu’il a pour substance un processus de transformation. C’est un chemin qui permet à celui qui accepte d’être néophyte d’accéder à un niveau d’être supérieur pourvu qu’il accepte et fasse l’effort de se transformer, ce qui veut dire qu’il renonce à ce « vieil homme » qu’il a traîné là. Entre l’avant et l’après, celui qui s’est engagé dans l’initiation effectue, selon les termes d'Elizabeth Feld dans l’article précité, une « migration d’identité ».
De quelle transformation de notre être intérieur, de quelle migration de notre identité notre confinement pourrait-il être l’opportunité ?
◊
Le rite initiatique implique l’épreuve, celle-ci pouvant revêtir des formes très diverses. Notre confinement, d’évidence, est une épreuve. Cela peut paraître paradoxal car il ne prive pas le plus grand nombre d’entre nous du confort matériel que notre civilisation place au dessus de tout. Nous aurions à faire en quelque sorte avec une «épreuve confortable». L’expression, d’évidence, est un un oxymore: la comprendre pourrait guider une quête.
Nous laisserons de côté le versant du confort. Nous ne sommes pas en panne de nourriture, de boisson, d’abri, d’Internet, de téléphone, de télévision ou même de papier-toilette. Ceux qui le sont l’étaient déjà avant le confinement et depuis longtemps. Sur le versant de l’épreuve, il y a matière à méditer. Il y a, osons le dire, l’expérience de la peur - de plusieurs peurs confusément mélangées - inédite pour la plupart d’entre nous. Puis, en opposition brutale à une époque qui prône l’accès de tout à tous à tout moment, il y a l’expérience d’une privation sévère de mobilité. Ici, par exemple, sur notre cote vendéenne, quelque solitaire que nous soyons, nous n’avons plus accès au littoral, aux quais, aux forêts, aux marais, à la mer. Mais, et peut-être surtout, le caractère le plus étrange de l’expérience du confinement est de ressentir sur soi une autorité qui, par sa surveillance, ses interdictions et les nouveaux rites qu’elle nous impose, nous enserre étroitement, pénétrant jusque dans notre sphère privée quand, par exemple, elle condamne les regroupements familiaux ou amicaux, la participation aux obsèques et aux cultes. On est très au delà du contrôle de vitesse sur les autoroutes.
N’en déplaise aux masochistes, l’épreuve en soi ne présente aucun intérêt si l’on n’y voit que la souffrance. La souffrance pour la souffrance n’a aucun sens, elle n’est pas une finalité. Si Jésus va jeûner dans le désert pendant quarante jours, Lui qui, plus tard, transformera l’eau en vin, multipliera les pains et les poissons et partagera le repas des pécheurs au nez et à la barbe des puritains, ce n’est pas pour la souffrance. En revanche, la nature de la privation nous dit quelque chose de la sublimation à accomplir ou de la compréhension à y gagner.
De quoi le confinement nous prive-t-il particulièrement ? Qu’est-ce que cela nous dit de la nature de la transformation personnelle et des changements de société que nous pourrions entreprendre dès notre « retour » ?
◊
Pour achever ce propos - mais non pour conclure sur son sujet - plus large est la question du « passage » collectif. Là, mon choix est de dire qu’il ne peut s’agir seulement de notre petit moi et des commodités qu’il veut retrouver. Il s’agit de nous, de la communauté des humains, de son histoire. L’ombre que projète sur nous l’invisible virus montre qu’à ce point de son parcours des questions essentielles sont posées à notre espèce.
Un passage est comme un gué. Nous y sommes. Pas encore au milieu.
D’où venons-nous tous ensemble et pourquoi ne devons-nous pas y revenir ? Où irons-nous tous ensemble une fois sur l’autre rive de notre confinement ?
(1) https://www.lafabriquenarrative.org/blog/blog/il-y-aura-u...
19:30 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : confinement, narrative, passage
24/03/2020
S’adapter
« Faut vous adapter ! »
Qui n’a jamais entendu cette injonction ?
Mais qu’est-ce que s’adapter ? Pour ceux qui profèrent cette injonction, c’est le plus souvent un appel à courber l’échine, à se soumettre ou se résigner. Pour ceux qui l’entendent dans le cadre de l’entreprise, c’est parfois l’annonce d’une fin de carrière qui leur donnera l’envie de fuir. Pour le sportif accidenté à qui l’on vient d’apprendre qu’il ne pourra plus randonner, escalader, nager ou piloter des bolides, c’est comme la fin anticipée de sa vie. Pour le voyou de banlieue face à la Justice, c’est le carburant de sa révolte.
Dans ma précédente chronique, j’évoquais les rencontres qui ont éclairé mon chemin intellectuel. Cette fois-ci, je ferai référence à Meyer Ifrah. A l’époque, je m’intéressais au concept de complexité et j’avais lu sur le sujet une interview de Meyer qui avait éveillé ma curiosité. Je vois encore notre première rencontre dans son bureau d’alors, dans le XVIIe. Il était allé à son tableau-papier et avait découvert une feuille vierge. « Vous voyez », m’avait-il dit, « là, il n’y a rien à dire ». Puis il avait pris un marqueur et tiré un trait noir, en travers, au hasard. « Là, ça devient intéressant. On peut commencer à réfléchir ». Cette entrée en matière très lacanienne m’avait plu et on a fait un bout de chemin ensemble. C’est Meyer, au cours de la formation qu’il dispensait (1) et de nos conversations, qui m’a fait comprendre les deux grandes formes d’adaptation: dans son vocabulaire, il parlait de survie et de croissance. A ce dernier terme, devenu trop connoté par la dérive économique destructrice, j’ai finalement préféré celui d’évolution.
Survie, évolution: de quoi s’agit-il ? Je vais recourir à un exemple historique: les suite de la débâcle française de 1940. L’armée de notre pays, sorti victorieux de la Grande Guerre - et à quel coût ! - est pulvérisée en quelques jours par les vaincus d’hier. J’ai pu parler de ce moment terrible avec un acteur et témoin oculaire de l’évènement: mon propre père. Alors militaire de carrière, avant que la nasse allemande se referme il avait tenté de regrouper des soldats errants, abandonnés par le sauve-qui-peut de leurs officiers. Deux hommes vont dominer la suite de l’histoire, deux hommes à la formation identique et qui ont vécu les mêmes évènements. Deux hommes au surplus qui ont été suffisamment intimes pour que l’un fût le parrain du fils de l’autre. Malgré ce qui les rapproche, ils vont prendre des décisions diamétralement opposées. L’un, à qui la précédente guerre a conféré un immense prestige, cherche à sauver les meubles, pactise, signe un armistice. Il devra ensuite reculer sans cesse devant les exigences croissantes de l’occupant. L’autre, sous-secrétaire d’Etat à la guerre, général de brigade à titre temporaire, inconnu du grand public, refuse la reddition. Il joue son va-tout et rejoint la Grande-Bretagne, ce qui lui vaut d’être condamné à mort par contumace. Là-bas, au milieu de mille difficultés, il incarne la France qui résiste et, à la Libération, évite que nous passions du joug de Berlin sous celui de Washington. Pétain et de Gaulle ont fait le choix de deux adaptations différentes: l’un, celle de la survie à une situation qu’il considère définitive, l’autre celle de l’évolution.
Selon la voie que vous prenez, survie ou évolution, les ressources que vous percevez sont différentes. Les épreuves que vous rencontrerez le seront aussi. L’écrasement inenvisagé de la France par le vaincu d’hier prend de court les militaires, les ministres, les parlementaires et la population. Pétain ne voit qu’une chose : la solitude de son pays face à un envahisseur écrasant alors même que les forces britanniques viennent de rembarquer à Dunkerque. De Gaulle voit plus loin que le désastre qu’il a lui aussi sous les yeux: il y a alors l’immense Empire français où préparer la reconquête et, la dynamique du conflit conduisant celui-ci à se mondialiser, les Etat-unis finiront par s’engager. Adaptation en survie d’un côté, dont le déplacement de la ligne de démarcation pourrait être la métaphore: on survit, en effet, mais en se renonçant de plus en plus. On prolonge l’agonie. De l’autre côté, l’adaptation en évolution qui, sinon la foi qui peut nous habiter, ne nous apporte pas de certitudes rassurantes et peut être de l’ordre d’un pari. Les coûts sont lourds des deux côtés, mais de nature différente. La question qui départage : qu’est-ce qui est essentiel ? L’adaptation en évolution vise à recouvrer l’essentiel.
Pourquoi dire qu’il s’agit d’une adaptation en évolution ? Parce qu’il s’agit évidemment, au lieu d’entériner qu'on la subira telle qu'elle est, de faire évoluer une situation afin d’y retrouver la satisfaction de nos besoins, la possibilité d’être et de vivre comme nous l’entendons. Mais aussi, adaptation en évolution parce que, pour y parvenir, l’on va devoir soi-même évoluer. Parce que l’on va devoir, à des degrés divers, changer sa posture, ses outils d’analyse, ses stratégies et, au bout du bout, développer de nouveaux talents. Pour rester sur le même moment de notre histoire, Jean-Luc Barré a montré dans Devenir de Gaulle que le personnage que nous connaissons, s’il avait fait une partie du chemin au point de se jeter « hors de toutes les séries » en rejoignant Londres, dut continuer de se forger « au rythme terrible des évènements ». La condition et la récompense de l’adaptation en évolution est l’évolution.
Il me revient une anecdote qui apportera une illustration complémentaire à mon propos. Celui qui me l’a contée avait été dans sa jeunesse curieux des arts martiaux. Mais, dans sa ville du Maroc, il n’y avait pas de cours ou bien il n’avait pas les moyens de les fréquenter régulièrement. Un jour, il apprend qu’un maître vient du Japon donner un séminaire et il décide d’aller voir. Comme il vient de se glisser dans la salle, quelques pratiquants apparemment chevronnés s’écrasent les doigts sur la planche que leur tend le maître. Je suppose que vous n’avez pas de mal à vous représenter la scène. Le maitre arrête l’exercice. « Savez-vous pourquoi vous ne brisez pas la planche ? » « On ne frappe pas assez fort ? » L’homme secoue la tête. « Que visez-vous ? » « La planche, évidemment ! » « Si vous visez la planche, comment voulez-vous la traverser ? Il vous faut viser un point au delà de l’obstacle si vous voulez briser l’obstacle ». Regarder au delà: une idée en entraînant une autre, je me souviens de l’observation du psychiatre Viktor Frankl, déporté avec sa famille. Ceux qui survivaient aux camps de la mort, raconte-t-il (2), se représentaient « l’après ».
Bien sûr, entre survie et évolution, il y a une possible position intermédiaire. Possible pourvu qu’elle soit provisoire. Le risque est fonction des situations. Pour un salarié, ce serait de s’habituer à son placard et d’attendre la retraite en perdant l'estime de soi. Pour une femme battue, de mourir un jour sous les coups. Pour un athlète devenu incapable de vivre sa passion, de vouloir en finir avec la vie. On peut être obligé de faire le gros dos, de panser des blessures, de mûrir une décision: l’essentiel est de rester droit à l’intérieur. Ce n’est pas forcément facile, mais si l’on reste courbé trop longtemps, on aura du mal à se redresser car c'est l'âme même qui se sera courbée comme une lame mal forgée.
Le philosophe Alain soulignait que les postures du corps influencent la pensée. C’est pourquoi, sans doute, on a ces bons petits soldats qui se retrouvent à conformer leur esprit en même temps que leurs comportements, et pour qui avoir une opinion personnelle équivaut à la désobéissance. Dans l’actualité, j’ai pêché hier (3) l’article d’un statisticien des épidémies qui s’émeut à juste titre des risques du confinement autoritaire. Il commence en déclarant: « (…) en ces temps de mobilisation collective, nous avons tous à respecter scrupuleusement les mesures qui sont imposées. Même si on doute de celles-ci ou qu’on les trouve inadaptées, aucun d’entre nous ne peut se donner le droit de suivre sa propre idée. Cette compliance - que je n’ai cessé de prôner - m’habite inconditionnellement". Mais il ajoute cet avertissement que je partage aussi entièrement: « cette obéissance civile ne doit surtout pas conduire à une interdiction de penser ou de parler. »
L’imprévu, surtout s’il est brutal, fait apparaître les structures habituellement cachées de notre psyché, les récits intérieurs qui nous tiennent lieu de logiciel et la capacité d’autonomie et de résilience qu’ils nous autorisent. Mais le soulagement du sauvetage recèle aussi ses dérives : celles dont le syndrome de Stockholm constitue les prémices.
Je vous propose de nous retrouver ici pour, en échangeant si vous le souhaitez nos expériences du confinement, prendre soin de nos besoins physiques, psychologiques et, osons le mot, spirituels. Et aussi pour préparer notre retour à la liberté.
Tirées de mon expérience, voici quelques questions qui pourraient recéler un peu de pertinence:
Vous souvenez-vous de moments de votre vie où vous avez fait l'expérience:
- de l'adaptation en survie ?
- de l'adaptation en évolution ?
Qu'en avez-vous retenu comme ressources pour le cas où des situations semblables se représenteraient ?
(1) Les 2L: selon Meyer Ifrah, les deux ressources fondamentales des humains sont le Lien et la Loi.
(2) Dans Le sens de la vie.
(3) http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-f...
15:52 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/03/2020
Du confinement intérieur
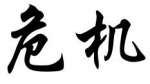
J’ai beaucoup travaillé avec des personnes qui, en raison de la focalisation à laquelle leur métier et leurs responsabilités les contraignaient, demandaient à « lever le nez du guidon ». Non pas pour faire du tourisme intellectuel, mais parce qu’elles étaient conscientes que l’on peut être pris au dépourvu quand, d’un lieu que notre regard n’embrassait pas, une perturbation nous atteint. Mes séminaires et mes « parcours de développement humain » ont pour ressort principal le rapport à l’imprévu. Pourquoi y a-t-il de l’imprévu ? De quelle manière nous préparons-nous à l’accueillir ? Comment nous adaptons-nous à sa survenance ? Voire: comment l’invitons-nous ? Il n’y a rien de gratuit dans cette démarche: nos histoires individuelles et collectives sont faites de bifurcations le plus souvent subies et parfois mal exploitées. Mais l’imprévu est une notion relative. En tant que formateur, mon objectif est d’éclairer le rôle de nos processus cognitifs et de faire en sorte qu’on accueille un « peut-être » à côté des certitudes qui peuplent nos esprits et engendrent la scotomie mentale. Ma philosophie pourrait se résumer ainsi: « Peut-être cela est-il étonnant, peut-être cela n’arrivera-t-il pas de notre vivant. Autorisons nous cependant à l’envisager: si cela vient à se produire, nous aurons une avance potentiellement salvatrice ».
Cet intérêt pour l’imprévu provient sans doute de mon expérience personnelle. Cela a pu commencer très tôt puisque je suis né avant terme et sous césarienne, mais je ne m’attarderai pas sur cette spéculation. A plusieurs reprises, dans ma vie, ce que je tenais pour sûr ou désirable a été balayé, parfois douloureusement. Avant d’être en âge scolaire, je voyais dans la rue les plus grands que moi partir à l’école et en revenir. C’était quelque chose de mystérieux et que j’avais envie de connaître. Un jour d’octobre 1953, par un petit matin clair et frais, mon tour vint. Au bout d’une heure de classe, je n’avais qu’un désir: m’enfuir ! Une quinzaine d’années plus tard, l’imprévu fut l’annonce que mon père, âgé de cinquante-sept ans, jusque là aussi vivant qu’on peut l’être, était condamné. Pour utiliser une expression que j’ignorais à l’époque, le « signal faible » dont on n’imagina pas ce qu’il annonçait fut un simple saignement des gencives. De la clinique toulousaine où on l’avait envoyé, mon père m’appela un soir, plein d’énergie et d’optimisme. Il rentrerait dans quelques jours. Je m’empressai de communiquer cette nouvelle à notre médecin de famille qui me répondit sobrement: « Pourriez-vous venir me voir ? » C’était le début de l’automne, il tombait des cordes mais, quand je laisse ce souvenir affleurer spontanément, j’ai aussi l’image d’innombrables flocons qui virevoltent. Je ne saurais dire laquelle de ces deux images, de la pluie ou de la neige, est juste. Le bon sens me dit seulement qu’en cette période de l’année ce ne pouvait être de la neige. Dix minutes plus tard, j’étais dans le cabinet du docteur et je l’entendais me lire le compte-rendu qu’il avait reçu du professeur qui avait pris mon père en charge. Littéralement : « Leucémie myéloblastique aiguë, pronostic sombre ». A l’époque, on dissimulait aux malades les diagnostics sans espoir, mais il fallait bien que quelqu’un de la famille fût informé. Ma mère étant dépressive, ma grand-mère fragile, bien que je n’eusse que vingt-et-un ans j’étais le seul à qui notre docteur pouvait dire la vérité. Je vous laisse à imaginer, outre l’horreur pour moi de cette nouvelle, le choc intérieur que fut la collision de ces informations contradictoires. Je pense que ce choc a joué un rôle décisif sur ma structure mentale. Il y a implanté ou en tout cas renforcé un principe de défiance associé à un désir aigu de voir au delà des ombres de l’illusion. L’allégorie platonicienne m’a permis d’ennoblir cette disposition, au point que « Les ombres de la caverne » est devenu le titre du livre que j’ai publié en 2011.
Il y eut, au cours de cette maladie fatale, un épisode singulier. Alors qu’il traversait une bonne période, mon père, qui ignora jusqu’à la fin la réalité de son état, décida un jour de surseoir à la prise de sang périodique. Ma mère, d’ordinaire si pointilleuse, l’approuva. Il est vrai qu’il paraissait en parfaite santé. Je connaissais le risque mais je ne pouvais pas le révéler. Je ne parvins pas à les faire changer d’avis. L’angoisse folle qui s’était emparée de moi se transforma alors en une tempête. Devant mes parents interloqués, j’explosai. Pour autant, je restai muet sur l’essentiel. Etait-ce à un fils de livrer à son père la cruelle vérité que les médecins jugeaient ne pas devoir lui dire ? Une semaine plus tard, le retour des malaises se chargea du reste. Bien que je n’aie pas exactement vécu le drame de Cassandre puisque je ne pouvais pas révéler la vérité, j’ai fait l’expérience d’avoir une conviction douloureuse que l’on ne parvient pas à partager.
Détenir une information que l’on ne peut dire ou qui ne rencontre que le rejet fait de vous un mouton noir. Soulever certaines questions aussi. Lors de la parution du premier « Rapport au Club de Rome » sur Les limites de la croissance, qui, selon moi, mettait le doigt sur une évidence - et nous le vérifions de nos jours - je ressentis à quel point j’étais une sorte d’original, expérience que j’avais faite dès mes premiers jours de classe et qui m’avait laissé désemparé. Il y a en moi quelque chose d’imperméable à certains conformismes. Le déni collectif n’entame pas mes convictions. Dans certains domaines, aujourd’hui, j’ai le réconfort d’être de moins en moins seul.
Ce désir de voir au delà des ombres, que j’ai évoqué plus haut, nourrit des années plus tard ma passion pour la prospective et, parallèlement, pour l’étude de ces phénomènes de déni, de rigidité mentale, de conformisme intellectuel qui nous rendent parfois aussi stupides que vulnérables. Je me souviens par exemple d’avoir organisé, au début des années 90, des séminaires sur le potentiel du commerce électronique et n’avoir recueilli sur le moment qu’un succès d’estime. A quelques années de là, certains des participants s’en souvinrent et j’eus des compliments a posteriori. Ce n’est pas que je sois particulièrement intelligent, mais avoir été en grande partie autodidacte m’a donné une liberté de pensée que ne bloquent pas des réflexes orthodoxistes ou de subordination définitive aux sachants. Je ne peux pas penser autrement que par moi-même, fût-ce en boitant. Ce n’est pas non plus que je sois un visionnaire, c’est seulement que, lorsque j’écoute ou lis certaines choses, j’ai une sorte d’intuition de ce qu’il serait pertinent de prendre en compte, quelque invraisemblable que cela puisse paraître dans le moment. Je me rappelle, par exemple, avoir fait intervenir le regretté Bernard Lietaer sur la crise des subprimes: alors que les économistes du 20 heures nous annonçaient qu’on aurait oublié tout cela dans deux mois, Bernard affirma que la crise serait longue et profonde. J’ai eu aussi le privilège d’inviter à témoigner Paul Jorion, revenu des Etats-unis, l’un des rares experts à pouvoir prouver aujourd’hui qu’il avait annoncé cette crise puisque, non sans mal, il avait réussi à faire publier avant qu'elle survienne un essai prophétique.
L’étude de l’histoire et des aveuglements qui la parsèment nourrit la réflexion prospective. J’ai évoqué en passant les difficultés rencontrées par Paul Jorion pour se faire publier tant ce qu’il annonçait semblait saugrenu. Peut-on encore rappeler, tellement elle est connue, la cécité de la firme Kodak dont un des jeunes ingénieurs avait inventé la photographie numérique et qui est morte de sa croyance dans la supériorité définitive de la photographie argentique ? Doit-on rappeler le sort dramatique du médecin Ignace Semmelweis (1818-1865), persécuté par ses pairs et mort dans la folie, pour avoir évoqué la possibilité que les hécatombes de femmes en couches dans les hôpitaux avaient quelque chose à voir avec un facteur invisible ? Doit-on rappeler les analyses de Paul Watzlawick sur le cercle infernal maintes fois observé qui consiste à faire toujours plus de la même chose alors même que l’on obtient toujours plus du contraire de ce que l’on recherche ?
Dans le cadre de mes prospections intellectuelles, j’ai eu la chance de rencontrer des esprits particulièrement affutés. Parmi d’autres que je citerai en d’autres occasions, m’a particulièrement marqué la fréquentation d’Andreu Solé, l’auteur de « Créateurs de Mondes ». Quand Andreu m’a montré qu’en amont de nos représentations, il y avait à notre insu un filtre aussi simple que puissant - nos possibles, impossibles et non-impossibles - et que ces filtres délimitaient le monde - pour ne pas dire le bocal - dans lequel nous vivons, ce fut pour moi le « Bon sang! Mais c’est bien sûr! » de l’inspecteur Bourrel. Cela explique que les oeuvres d’imagination soient parfois plus pertinentes que les exercices de prévision rédigés par les « réalistes », car le réalisme n’est qu’un assemblage de préjugés dont le statut de la fiction permet de se libérer. Un petit rayon de ma bibliothèque rassemble quelques-uns des ouvrages qui me paraissent lourds de pertinence de ce point de vue-là. Impossible, le naufrage du Titanic, pourtant décrit avec une étonnante précision, en 1898, par Morgan Robertson dans son roman Futility ? Impossible que des terroristes détournent des avions et les jettent sur les deux tours de New York ? Tom Clancy l’a cependant imaginé dans son roman Sur ordre, paru en 1996. Impossible l’existence d’un facteur invisible d’infection proposée par le malheureux Semmelweis ?
Ces dernières années, ma réflexion s’est étendue à la manière dont nous vivons nos vies personnelles, car ce triple filtre des possibles, impossibles et non-impossibles, évidemment nous confine. J’ai raconté ailleurs comment il me fallut la menace subite d’une grave maladie pour que je sorte de l’invisible prison que je m’étais construite et que je m’ouvre à la possibilité de devenir ce que jusque là je n’aurais pu ni souhaiter ni même imaginer. Les personnes qui recourent aux Approches narratives font la même expérience quand elles prospectent patiemment dans leur autobiographie les « fines traces » de celui ou celle qu’il y a en eux à leur insu, qu’une histoire dominante a refoulé.
Je vous propose de nous retrouver ici pour, en échangeant si vous le souhaitez nos expériences du confinement, prendre soin de nos besoins physiques, psychologiques et, osons le mot, spirituels. Et aussi pour préparer notre retour à la liberté.
Tirées de mon expérience, voici quelques questions qui pourraient recéler un peu de pertinence:
Quels sont les principaux possibles, impossibles et non-impossibles que vous avez vu basculer dans votre vie ?
Quels sont les principaux possibles, impossibles et non-impossibles qui pourraient basculer dans un proche avenir ?
Dans ce cadre, quel bien pourriez-vous vous faire à vous-même ?
18:41 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : confinement, prospective, biais cognitifs, liberté, imprévu, développement personnel


